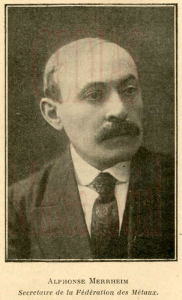
Alphonse Merrheim | archives IHS CGT métaux
Évoquer la vie d’Alphonse Merrheim en 2014, c’est réfléchir sur des aspects de l’histoire du syndicalisme qui, à plus d’un siècle de distance, ont gardé une actualité bien réelle, comme la concentration accélérée des entreprises, la place de la finance dans l’économie, la puissance du patronat métallurgique, les conséquences du taylorisme, les formes d’organisation du mouvement syndical, l’importance de l’éducation des travailleurs et bien entendu l’internationalisme et la lutte contre la guerre.
En dépit de son rejet de la révolution bolchevique et de son ralliement après-guerre aux tenants du « réformisme », Merrheim reste bien, pour reprendre les mots de l’historien Édouard Dolléans, une « figure dominante du mouvement ouvrier à cette époque critique de son histoire ».
L’impossibilité de traiter l’intégralité d’une vie en si peu de temps a bien évidemment conduit à procéder à des choix. La vie de Merrheim sera donc abordée ici sous l’angle de son engagement pacifiste et antimilitariste.
Alphonse Merrheim est né dans une famille ouvrière de La Madeleine (Nord) le 7 mai 1871, alors que la Commune de Paris battait son plein. Chaudronnier de formation, il œuvra à la reconstitution de son syndicat dont il assuma les fonctions de secrétaire de 1893 à 1904. Un an plus tôt, la Fédération du cuivre, à laquelle il appartenait, intégra l’Union fédérale des ouvriers métallurgistes et Alexandre Bourchet, secrétaire général de la première devint secrétaire de la seconde. Ce dernier démissionna en 1904 et ce fut Merrheim qui reprit cette tâche, non sans hésitations.
Alphonse Merrheim, une figure économique de la CGT (1904-1909)
Entre 1904 et 1909, Merrheim changea de stature et devint un dirigeant d’envergure nationale.
On lui confia rapidement la gestion de grèves particulièrement dures : Cluses (1904), Longwy (1905), Hennebont (1906) ou encore celles du Nord (1907). De ces expériences, il tira de solides monographies publiées par Le Mouvement socialiste ainsi que des enseignements sur la puissance du patronat métallurgique et sur la nécessité pour les travailleurs de s’organiser en fédérations d’industrie.
Il entama, avec le journaliste Francis Delaisi, un travail d’analyse approfondi sur le patronat et sur les structures économiques de la métallurgie, dans les domaines de la technique et de l’économie politique. À l’instar de Fernand Pelloutier avant lui, il était persuadé de l’importance de la formation des militants dans ces domaines. Selon lui, les travailleurs ont besoin d’un patient travail d’organisation syndicale et d’éducation avant de pouvoir espérer renverser la société capitaliste.
Il a ainsi publié en 1908 une étude sur le Comité des Forges, puis une série d’articles intitulée « L’organisation patronale en France » parue dans Le Mouvement socialiste entre 1908 et 1909 et surtout, en 1913, une vaste étude intitulée La Métallurgie, son origine et son développement. Les forces motrices, dans laquelle il analyse la concentration des entreprises, la multiplication des trusts et des cartels et l’essor de la taylorisation. Sa participation à la création de La Vie ouvrière dirigé par son ami Pierre Monatte en 1909 relève également de cette préoccupation de former les militants.
Conscient de la faiblesse du syndicalisme de métiers face au tout-puissant patronat métallurgique, il joua également un rôle central dans la mise en place en 1909 de la Fédération des ouvriers sur métaux regroupant l’ensemble des métiers. Celle-ci comprenait l’Union fédérale des ouvriers métallurgistes, la Fédération des modeleurs, celle des mouleurs et celle des chauffeurs-conducteurs. Elles furent rejointes en 1911 par la Fédération des mécaniciens et enfin par celle des ferblantiers l’année suivante.
Alphonse Merrheim et l’antimilitarisme (1908-1914)
Ces réflexions économiques l’ont parallèlement renforcé dans ses convictions antimilitaristes. Farouchement opposé à l’armée, il considérait, comme de nombreux syndicalistes, que celle-ci était un rempart dressé par le capitalisme[1].
La spécificité de Merrheim fut d’être rapidement convaincue de l’imminence d’une guerre entre les puissances européennes. Si Delaisi le devança en publiant un premier article dès 1905[2], Merrheim s’illustra par sa campagne d’alerte lancée à partir de 1909, dont la Vie ouvrière se fit l’écho en publiant sa série d’articles intitulée « L’approche de la guerre ». Autre exemple, il retraça, en décembre 1912, les principales évolutions connues par l’Europe depuis 1870 et prédit les conséquences d’une guerre totale entre impérialismes. Cette clairvoyance ne fut pas récompensée et il dut affronter les sarcasmes.
Il joua toutefois un rôle incontournable au niveau national sur cette question. Bon nombre de ses propositions ont en effet façonné l’attitude officielle de la CGT sur le militarisme.
Merrheim fut le partisan d’un antimilitarisme corporatif, pour reprendre les termes de l’historien Jacques Julliard. Selon lui, l’antimilitarisme devait aider à inculquer des notions révolutionnaires dans la conscience des travailleurs, grâce à des exemples concrets, comme l’utilisation de l’armée contre les piquets de grèves. Selon lui, une campagne antimilitariste devait donc davantage favoriser la cohésion des organisations syndicales qu’être une révolution contre l’État.
À ce titre, il s’opposa à la motion présentée par Georges Yvetot lors du congrès confédéral de 1906 (Amiens) et rejoignit ceux qui en rejetaient l’orientation antipatriotique et insurrectionnelle. Celle-ci fut tout de même adoptée à une courte majorité et la CGT connut un regain de surenchère verbale alimentée par les partisans de Gustave Hervé, regroupés autour du journal La Bataille sociale.
Il fut l’habile artisan, lors du congrès confédéral de 1908 (Marseille), de l’adoption d’une résolution de compromis entre partisans de la grève générale insurrectionnelle et partisans d’un syndicalisme limité à l’action économique. Celle-ci est restée célèbre grâce à la formule suivante : « le congrès déclare qu’il faut, du point de vue international, faire l’instruction des travailleurs afin qu’en cas de guerre entre puissances, les travailleurs répondent à la déclaration de guerre par une déclaration de grève générale révolutionnaire. »
Ce compromis, adopté par 670 voix contre 406, a créé l’illusion que la CGT lançait un appel automatique et inconditionnel à la grève générale, ce qui en réalité est faux.
« Du point de vue international » renvoie aux difficultés rencontrées par la CGT pour imposer l’idée d’une riposte coordonnée des travailleurs en Europe et notamment en Allemagne où les organisations syndicales se défaussent de leurs responsabilités sur le Parti social-démocrate. Lancer une grève générale isolée serait contre-productive.
« Faire l’instruction des travailleurs » renvoie là à la préoccupation centrale d’Alphonse Merrheim en matière d’éducation syndicale. On notera ici que cette nécessité d’instruire les travailleurs conditionne l’appel à la grève générale révolutionnaire.
Préoccupé par l’approche de la guerre, Merrheim l’était également par la situation de la classe ouvrière en France : faiblesse organisationnelle du mouvement syndical, déficiences dans l’éducation des travailleurs, puissance de l’État et de la bourgeoisie. Considérant que ces obstacles comme insurmontables dans l’immédiat, Merrheim s’opposa aux tenants de la grève générale et privilégia une définition syndicale limitée de la lutte contre l’armée.
Lors du congrès confédéral de 1912 (Le Havre), il se heurta à Raymond Péricat qui appelait à la désertion des soldats. Il recommanda à l’inverse de développer le « Sou du soldat » et d’éviter de fournir un prétexte au gouvernement pour mettre au pas la CGT.

La grève à Longwy (1905) | archives IHS CGT métaux
Lors du congrès confédéral extraordinaire de novembre 1912, Merrheim dirigea la commission chargée de présenter la motion antimilitariste. Celle-ci émit de sérieux doutes sur la capacité de la CGT à organiser une manifestation nationale et encore moins une coordination internationale des efforts. L’échec de la grève générale du 16 décembre 1912 conforta les dirigeants de la CGT dans leurs analyses.
L’année 1913 fut marquée par la poursuite de cette politique notamment portée par Merrheim. Cette défense de la ligne modérée de Léon Jouhaux fut dénoncée vigoureusement par l’Union des métaux de la Seine. Le congrès fédéral de septembre 1913 fut l’occasion de régler les comptes, dans un contexte de reflux des adhésions et d’échec des grèves. La non-rééligibilité des permanents syndicaux et l’orientation générale du syndicalisme furent les deux points de confrontation. Finalement l’Union des métaux de la Seine, mise en minorité, décida l’exclusion de Merrheim de ses rangs en janvier 1914, ce à quoi répondit la Fédération par une exclusion de l’Union en juin 1914.
Ces déchirements, à la veille de l’entrée en guerre, ne furent bien évidemment pas propices à la mobilisation des travailleurs.
Au final, le ralliement de la CGT à l’Union sacrée en août 1914 n’est pas une trahison des positions prises lors des congrès mais plus le constat d’un échec : la CGT a été incapable d’éduquer le prolétariat français et de convaincre les organisations étrangères du bien-fondé de sa position.
Alphonse Merrheim face à la guerre (1914-1917)
L’assassinat de Jaurès, la peur des arrestations (voire des exécutions[3]), la déclaration de guerre allemande ainsi que le patriotisme expliquèrent le ralliement à la guerre de la grande majorité de la CGT et de ses dirigeants nationaux au cours du mois d’août 1914.
La Fédération des métaux, comme les autres organisations de la CGT, fut profondément désorganisée par l’entrée en guerre. La mobilisation et les pertes au combat se traduisirent par un effondrement des effectifs alors que le repli des industries métallurgiques des régions traditionnelles du nord-est vers le sud ajouta à la confusion de la situation. De 36 000 syndiqués en 1913, la fédération passa à 1 400 en 1915 ! Dans la métallurgie, la militarisation des ouvriers interdit en outre toute action revendicative concertée. Millerand, recevant une délégation des Métaux en janvier 1915, annonça ainsi qu’en raison de la guerre, il n’y avait plus de droits ouvriers.
La fédération pris ses distances avec la majorité favorable à l’Union sacrée. L’acceptation, par Léon Jouhaux, d’un mandat de « Commissaire à la Nation » fut vigoureusement dénoncée par Merrheim qui s’opposa également au départ du bureau confédéral pour Bordeaux en septembre 1914. Il ne rompit toutefois pas, comme son ami Monatte, avec la majorité en janvier 1915 et accepta de conserver ses responsabilités fédérales et confédérales.
Il participa toutefois, dès la fin du mois d’octobre 1914 au lancement d’une campagne anti-guerre avec des militants regroupés autour de La Vie ouvrière.
En avril 1915, il fut décidé de relayer l’appel des ouvriers socialistes allemands publié un mois plus tôt. Ce texte se prononçait pour la paix, non une paix militariste, non une paix avec conquête impérialiste, mais une paix basée sur les principes suivants : pas d’annexions, l’indépendance politique et économique de chaque nation, le désarmement général, l’arbitrage obligatoire des conflits internationaux.
Le 1er mai 1915 fut l’occasion pour Merrheim de frapper un grand coup en publiant un numéro de L’Union des métaux et en organisant des meetings d’action contre la guerre. Ces initiatives, condamnées par Jouhaux, lui valurent de solides inimitiés et une surveillance policière accrue.
L’organisation de cette campagne et sa conviction de l’importance de rétablir les relations entre organisations du mouvement ouvrier européen lui valurent de participer, avec Albert Bourderon[4], à la Conférence de Zimmerwald de septembre 1915. Lénine y défendit la rupture avec la Seconde Internationale et la création d’une nouvelle Internationale, révolutionnaire, ainsi que l’appel à la grève générale immédiate des travailleurs et des militaires contre la guerre. Merrheim s’y opposa et se rallia aux tenants d’une résolution non-révolutionnaire.
De retour en France, Merrheim prit la tête du mouvement pour la paix et lança, avec d’autres militants, le « Comité d’Action Internationale » à la fin du mois de novembre 1915 pour diffuser les positions adoptées à Zimmerwald. Celui-ci devint, au début de l’année 1916, le « Comité pour la reprise des relations internationales » (CRRI) qui comptait alors deux commissions : l’un syndicaliste, l’autre socialiste.
Merrheim ne put se rendre à la seconde conférence, en avril 1916 à Kienthal. Celle-ci adopta des positions plus radicales et, signe d’un changement d’atmosphère, Merrheim vit son influence se réduire en France au profit des partisans de la ligne léniniste dont Raymond Péricat était le représentant. Il ne soutint pas la transformation de la commission syndicaliste du CRRI en Comité de Défense Syndicaliste (le fameux CDS) en mars 1917. Il justifia cette position par sa volonté de préserver coûte que coûte l’unité du mouvement ouvrier français.
L’année 1917 constitua un tournant dans la Première Guerre mondiale[5]. La multiplication des grèves et des grévistes, la progression spectaculaire des effectifs de la CGT renouvela en profondeur la base militante du syndicalisme et favorisa la progression des minoritaires à travers le CDS. Le métallurgiste devint, au cours des années 1917-1918 le personnage central, avec le cheminot, de la main-d’œuvre parisienne et sans doute nationale.
Pourtant, Merrheim, qui symbolisait l’opposition depuis trois ans, se rapprocha de la direction confédérale. Depuis la fin de l’année 1916, entre Lénine et Wilson, il avait fait porter ses choix sur le second et il fut finalement exclu du CDS en juin 1917. La révolution d’Octobre accéléra son évolution, lui qui dénonçait toute perspective de paix séparée entre la Russie et l’Allemagne et toute scission dans les organisations ouvrières. Il resta également marqué, comme l’ensemble de la classe ouvrière, par le nationalisme.
Le ralliement définitif de Merrheim à la majorité (1918-1919)
De nombreux exemples illustrent le fait que l’hostilité de Merrheim envers Jouhaux, bien que réelle, n’était pas irréversible. Le fil ne fut jamais rompu dans la mesure où son action pour la paix n’est jamais allée jusqu’à préparer des actions contre le gouvernement ou pour la révolution. La réconciliation avec Jouhaux et les majoritaires fut faite par étapes au cours de l’année 1918, même s’il est possible de trouver des prémisses dès la seconde moitié de l’année 1917.
Merrheim repoussa ainsi l’organisation d’une grève générale le 1er mai 1918 et ne soutint pas la grève spontanée des métallurgistes de la vallée de la Loire. Lors du congrès de la Fédération des travailleurs de la métallurgie en juillet 1918, Merrheim se défendit de son manque d’implication et fut soutenu par une majorité des délégués. Il défendit avec enthousiasme le Programme minimum de la CGT de 1918 qui se plaçait sous le patronage des Quatorze points de Wilson. Il fut un partisan de la relance de l’économie et de la mise en veilleuse des revendications des travailleurs pour retrouver rapidement une situation économique normale. Il refusa le principe de la grève générale qui ne ferait, selon lui, qu’accroître la famine et les désorganisations.
Les tensions entre Merrheim et minoritaires d’hier se cristallisèrent en 1919 sur deux questions : la négociation nationale de l’application des huit heures dans la métallurgie par les secrétaires fédéraux avec l’UIMM en mai et les vastes grèves de l’été 1919 où les métallurgistes jouèrent un rôle important. Pas moins de 170 000 métallos se mirent ainsi en grève au mois de juin 1919. Leur échec fut pour partie du à l’attitude de Merrheim qui refusa de prendre en compte les revendications politiques (reconnaissance par le gouvernement de la révolution bolchevique, amnistie pour les prisonniers politiques et militaires, lancement de la démobilisation) et se cantonna aux revendications économiques. En poussant à la négociation des revendications économiques avec le patronat et le gouvernement, il a joué un rôle majeur dans la fin de la grève.
Le congrès de la Fédération de la métallurgie, puis celui de la Confédération en 1919 furent l’occasion pour les minoritaires d’attaquer durement Merrheim. La rupture était consommée.
La scission de la CGT, en 1921, provoqua chez Merrheim une violente opposition à l’égard des bolcheviques, au point de comparer Lénine au général Boulanger. Ce rejet ne cessera pas, jusqu’à sa mort en octobre 1925.
Conclusion
En conclusion, l’acharnement de Merrheim à faire triompher la paix lui valu d’être considéré par ses contemporains comme un révolutionnaire engagé, d’autant plus que les hervéistes, ses partisans de l’antipatriotisme, avaient rallié l’union sacrée à toute allure. Toutefois, il n’a jamais troqué sa position contre la guerre pour celle de la révolution.
En ce sens, on ne peut pas vraiment parler de trahison de son passé révolutionnaire, de sa campagne contre la guerre et de ses amis de la minorité. En effet, le refus d’un programme révolutionnaire était bien réel avant et durant la guerre. Sa position n’a guère changé, contrairement à la situation politique et économique et au durcissement des positions de la minorité. S’il a conservé sa rhétorique révolutionnaire intacte, ses positions se réclamant du syndicalisme-révolutionnaire l’ont plutôt rapproché de la majorité réformiste. La paix de Brest-Litovsk et la scission du mouvement socialiste et syndical en 1920 et 1921 achevèrent de le convaincre de rejoindre les majoritaires.
Pour reprendre les mots de l’historien Romain Ducoulombier, Merrheim, attentif à « l’immédiat concret » du fait de ses préoccupations pour l’économie, incarna à son insu les progrès de cette lente conversion d’une partie du syndicalisme français à un idéal gestionnaire, réformiste, débutée par le discours de Jouhaux à l’enterrement de Jean Jaurès en août 1914 et définitivement scellée par l’échec des grèves de 1920.
[1]Ce sentiment, né à l’occasion du rôle joué par l’armée lors de la Commune de Paris, est renforcé par l’usage répété de l’armée par le gouvernement pour briser les grèves : Fourmies (1891), Carmaux, Montceau, Draveil-Villeneuve-Saint-Georges (1908) par exemple. Parmi les actions engagées par la CGT, notons celle du « Sou du soldat », caisse de solidarité pour les syndiqués assurant leur service militaire, créée en 1900 et relancée en 1910.
[2]Voir par exemple, « Bruits de guerre », Pages libres, n° 236, 8 juillet 1905, pp. 29-40.
[3]Adolphe Messimy, ministre de la Guerre, réclame ainsi, en visant les antimilitaristes : « Donnez-moi une guillotine et je vous garantis la victoire ».
[4]Secrétaire général de la Fédération du tonneau, il représente la SFIO.
[5]Entrée des États-Unis en guerre, chute du tsarisme en Russie, Révolution russe, hiver 1917 particulièrement rude, échec sanglant du Chemin des Dames, multiplication des mutineries, arrivée de Clemenceau au pouvoir.
Annexes
- Bibliographie et sources
- Principaux écrits d'Alphonse Merrheim
- Nécrologie
- Métallos syndiqués et grévistes
Le syndicalisme face à la guerre
Seules les principales références consacrées spécifiquement au mouvement ouvrier face à la Première Guerre mondiale sont recensées ici.
Jean-Jacques Becker, Le Carnet B. Les Pouvoirs publics et l’antimilitarisme avant la guerre de 1914, Paris, Seuil, 1973.
Jacques Julliard, « La CGT devant la guerre », Le Mouvement social, n° 49, octobre-décembre 1964, pp. 47-62.
John Horne, Labour at war, France-Britain, 1914-1918, Oxford, Clarendon Press, 1991, 464 pages.
Annie Kriegel, Aux origines du communisme français, 1914-1920. Contribution à l’histoire du mouvement ouvrier français, Paris-La Haye, Mouton, 1964, deux volumes, 995 pages.
Jean-Claude Lamoureux, Les dix derniers jours : 26 juillet-4 août 1914, Paris, Berlin, Bruxelles : du refus de la guerre à l’exaltation patriotique, Paris, Les Nuits rouges, 2013, 149 pages.
Jean-Jacques Becker, Annie Kriegel, 1914, la guerre et le mouvement ouvrier français, Paris, Armand Colin, 1964, 224 pages.
Jean-Louis Robert, Les ouvriers, la patrie et la Révolution : Paris 1914-1919, Besançon, Annales littéraires de l’université de Besançon, 1995, 484 pages.
Alfred Rosmer, Le mouvement ouvrier pendant la Première Guerre mondiale. Tome 1. De l’union sacrée à Zimmerwald, Paris, Librairie du travail, 1936, 568 pages.
Alfred Rosmer, Le mouvement ouvrier pendant la Première Guerre mondiale. Tome 2. De Zimmerwald à la Révolution russe, Paris, Mouton, 1959, 252 pages.
À signaler également, les éditions EDHIS, connues pour la reproduction de documents inédits de l’histoire du mouvement républicain et ouvrier ont une collection de sept volumes sur « le mouvement ouvrier contre la guerre 1914-1918 ».
Le syndicalisme dans la métallurgie (1914-1918)
« Cent années de luttes et d’acquis sociaux », Le Guide du Militant de la Métallurgie, n° 213, avril 1991, 72 pages.
Bertrand Abhervé, La grève des métallurgistes parisiens de juin 1919, Université Paris VIII, Mémoire de maîtrise d’histoire sous la direction de Claude Willard, 1973, 199 pages.
Henri Barreau, Histoire inachevée de la convention collective nationale de la métallurgie, Paris, FTM, 1976, 207 pages.
Jane Bond-Howard, The syndicat des métallurgistes de Bourges during the 1914-1918 war : a study of a minoritaire Made-Union, London University College, Mémoire d’histoire, 1984, 309 pages.
Christian Gras, « La Fédération des Métaux en 1913-1914 et l’évolution du syndicalisme révolutionnaire français », Le Mouvement social, n° 77, octobre-décembre 1971, pp. 85-111.
Nicholas Papayanis, « Masses révolutionnaires et directions réformistes : les tensions au corps des grèves des métallurgistes français en 1919 », Le Mouvement social, n° 93, octobre-décembre 1975, pp. 51-73.
Nicholas Papayanis, « Collaboration and pacifism in France during World War I », Francia, Band 5, 1977, pp. 425-451.
Jean-Louis Robert, Robert Chavance, « L’évolution de la syndicalisation en France de 1914 à 1921. L’emploi de l’analyse factorielle de correspondances », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, n° 5, septembre-octobre 1974, pp. 1092-1108.
Jacques Varin, Les hommes du métal, Paris, Messidor-FTM, 1986, 286 pages.
Judith E. Vichniac, The management of labor : the British and French iron and steel industries, 1860-1918, Greenwich, JAI Press, 1990, 244 pages.
Au sujet d’Alphonse Merrheim
Théodore Bérégi, « Grandes figures du monde ouvrier. Alphonse Merrheim », La Revue Socialiste, pt. II, n° 197, octobre-novembre 1966, pp. 336-339.
Pierre Brizon, « Merrheim », La Vague. Hebdomadaire de combat, socialiste, féministe, n° 2, 12 janvier 1918, p. 1.
Victor Daline, « Alphonse Merrheim et sa « correspondance confidentielle », in Victor Daline, Hommes et idées, Moscou, Éditions du Progrès, 1983, pp. 232-342.
Édouard Dolléans, « Grande figure du mouvement ouvrier, Merrheim », Syndicats, n° 29, 29 avril 1937, p. 5.
Édouard Dolléans, Alphonse Merrheim, Paris, Librairie syndicale, 1939, 48 pages.
Henri Dubief, « Alphonse Merrheim », in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, Paris, Éditions ouvrières, 1976, volume XIV, pt. III, pp. 70-73.
Christian Gras, « Alphonse Merrheim et le capitalisme », Le Mouvement social, n° 63, avril-juin 1968, pp. 143-163.
Maxime Leroy, « Griffuelhes et Merrheim », L’Homme Réel, n° 40, avril 1937, pp. 9-14.
René de Marmande, « Présentation d’extraits du discours d’Alphonse Merrheim à la Ligue des Droits de l’Homme, 17 mai 1921 », Syndicats, n° 136, 17 mai 1939, p. 2.
René de Marmande, « Les Amis de Merrheim », Syndicats, n° 135, 10 mai 1939, p. 2.
Pierre Monatte, « Alphonse Merrheim », La Révolution Prolétarienne, n° 11, novembre 1925, pp. 11-12.
Pierre Monatte, « Les polémiques de L’Humanité », La Vie ouvrière, n° 29, 5 décembre 1910, pp. 766-784 et n° 30, 20 décembre 1910, pp. 824-853.
Nicholas Papayanis, Alphonse Merrheim. The Emergence of Reformism in Revolutionary Syndicalism (1871-1925), Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, IISH, 1985, 184 pages.
Nicholas Papayanis, « Alphonse Merrheim and the strike of Hennebont. The struggle for the Eight-Hour Day in France », International Review of Social History, vol. XVI, 1971, pt. 2, pp. 159-183.
Georges Pioche, « Merrheim », Les Hommes du Jour, n° 499, 10 novembre 1917, pp. 1-2.
Georges Pioche, « Portraits. Merrheim », La Vérité, n° 34, 18 janvier 1918, p. 3.
Principaux articles parus
À noter que la revue Le Mouvement socialiste est partiellement disponible en ligne sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF.
« Enquête sur l’idée de patrie et de la classe ouvrière », Le Mouvement socialiste, n° 166-167, 1-15 novembre 1905, pp. 328-333.
« Le mouvement socialiste dans le bassin de Longwy », Le Mouvement socialiste, n° 168-169, 1-15 décembre 1905, pp. 425-482.
« Un grand conflit social. La grève d’Hennebont », Le Mouvement socialiste, n° 180, novembre 1906, pp. 194-218.
« Un grand conflit social. La grève d’Hennebont », Le Mouvement socialiste, n° 181, décembre 1906, pp. 347-379.
« La crise de l’automobile », Le Mouvement socialiste, n° 195, 15 février 1908, pp. 81-100.
« La crise de l’automobile », Le Mouvement socialiste, n° 196, 15 mars 1908, pp. 171-183.
« Enquête ouvrière sur la crise de l’apprentissage », Le Mouvement socialiste, n° 198, 15 mai 1908, pp. 327-338.
« L’organisation patronale en France », Le Mouvement socialiste, n° 200, 15 juillet 1908, pp. 5-25.
« L’organisation patronale en France », Le Mouvement socialiste, n° 201, 15 août 1908, pp. 81-95.
« L’organisation patronale en France », Le Mouvement socialiste, n° 202, 15 septembre 1908, pp. 178-197.
« L’organisation patronale en France », Le Mouvement socialiste, n° 203, 15 octobre 1908, pp. 270-277.
« L’organisation patronale en France », Le Mouvement socialiste, n° 204, 15 novembre 1908, pp. 339-362.
« L’organisation patronale en France », Le Mouvement socialiste, n° 205, 15 décembre 1908, pp. 408-425.
« L’organisation patronale en France », Le Mouvement socialiste, n° 209, avril 1909, pp. 284-289.
« L’organisation patronale en France », Le Mouvement socialiste, n° 211, juin 1909, pp. 431-448.
« L’organisation patronale en France », Le Mouvement socialiste, n° 215-216, novembre-décembre 1909, pp. 321-346.
« Comment j’ai découvert l’Ouenza », La Révolution, n° 4, 4 février 1909, p. 1.
« L’affaire de l’Ouenza », La Révolution, n° 25, 25 février 1909, p. 1.
« L’affaire de l’Ouenza », La Révolution, n° 26, 26 février 1909, p. 1.
« L’affaire de l’Ouenza », La Révolution, n° 27, 27 février 1909, p. 2.
« L’affaire de l’Ouenza », La Révolution, n° 28, 28 février 1909, p. 1.
« Un scandale capitaliste. L’affaire de l’Ouenza », Le Mouvement socialiste, n° 208, mars 1909, pp. 178-205.
« Les événements d’Espagne et le capitalisme au Maroc », Le Mouvement socialiste, n° 213, septembre 1909, pp. 116-120.
« Tout pour la mort ! Rien pour la vie ! », La Voix du Peuple, n° 466, 29 août-5 septembre 1909, p. 2.
« L’accaparement de la houille blanche », La Vie ouvrière, n° 1, 5 octobre 1909, pp. 43-60.
« Les soudeurs bretons », La Vie ouvrière, n° 3, 4 novembre 1909, pp. 141-160.
« La crise syndicaliste », Le Mouvement socialiste, n° 215-216, novembre-décembre 1909, pp. 291-304.
« L’escroquerie des retraites ouvrières », La Vie ouvrière, n° 7, 5 janvier 1910, pp. 1-15.
« Les retraites ouvrières et le projet de loi », Le Mouvement socialiste, n° 217, janvier 1910, pp. 21-45.
« L’affaire de l’Ouenza », La Vie ouvrière, n° 9-10, 5 et 20 février 1910, pp. 129-150.
« L’affaire de l’Ouenza », La Vie ouvrière, n° 11, 5 mars 1910, pp. 287-307.
« L’affaire de l’Ouenza », La Vie ouvrière, n° 12, 20 mars 1910, pp. 346-363.
« La parlementarisation du syndicalisme », Le Mouvement socialiste, n° 220, avril 1910, pp. 241-247.
« La suppression des économats et la Meurthe-et-Moselle », La Vie ouvrière, n° 13, 5 avril 1910, pp. 408-419.
« La suppression des économats et la Meurthe-et-Moselle », La Vie ouvrière, n° 14, 20 avril 1910, pp. 508-509.
« La suppression des économats et la Meurthe-et-Moselle », La Vie ouvrière, n° 19, 5 juillet 1910, pp. 48-52.
« Les serfs de Meurthe-et-Moselle », La Vie ouvrière, n° 22, 20 août 1910, pp. 193-211.
« Les serfs de Meurthe-et-Moselle », La Vie ouvrière, n° 23, 5 septembre 1910, pp. 271-289.
« Le congrès international des ouvriers sur métaux », Le Mouvement socialiste, n° 227, janvier 1911, pp. 47-51.
« Le congrès international des ouvriers sur métaux », Le Mouvement socialiste, n° 229, mars 1911, pp. 212-221.
« L’approche de la guerre », La Vie ouvrière, n° 31, 5 janvier 1911, pp. 1-17.
« L’approche de la guerre », La Vie ouvrière, n° 32, 20 janvier 1911, pp. 101-113.
« L’approche de la guerre », La Vie ouvrière, n° 33, 5 février 1911, pp. 129-141.
« L’approche de la guerre », La Vie ouvrière, n° 34, 20 février 1911, pp. 242-248.
« Compagnies minières et sociétés métallurgiques », La Vie ouvrière, n° 37, 5 avril 1911, pp. 388-397.
« La conférence internationale de l’acier », La Vie ouvrière, n° 45, 5 août 1911, pp. 129-143.
« La conférence internationale de l’acier », La Vie ouvrière, n° 46-47, 20 août-5 septembre 1911, pp. 288-306.
« Patriotisme et capitalisme », La Voix du Peuple, n° 590, 14-21 janvier 1912, p. 1.
« Les mineurs se lèveront-ils ? », La Vie ouvrière, n° 58, 20 février 1912, pp. 241-277.
« Jusqu’où iront-ils ? », La Voix du Peuple, n° 602, 7-14 avril 1912, pp. 2-3.
« Ce qu’a vu un évêque en Meurthe-et-Moselle », La Bataille syndicaliste, n° 510, 17 septembre 1912, p. 1.
« La journée de huit heures dans les usines à feu continu », La Vie ouvrière, n° 75, 5 novembre 1912, pp. 178-190.
« Le congrès confédéral contre la guerre », La Vie ouvrière, n° 76, 20 novembre 1912, pp. 285-289.
« La méthode Taylor », La Vie ouvrière, n° 82, 20 février 1913, pp. 210-226.
« La méthode Taylor », La Vie ouvrière, n° 83, 5 mars 1913, pp. 298-309.
« La méthode Taylor. Une discussion », La Vie ouvrière, n° 108, 20 mars 1914, pp. 345-362.
« La méthode Taylor. Une discussion », La Vie ouvrière, n° 109-110, 5-20 avril 1914, pp. 385-398.
Jules Raveté, « Une discussion sur le système Taylor. Brèves observations pour Merrheim », La Vie ouvrière, n° 116, 20 juillet 1914, pp. 103-111.
« Une discussion sur le système Taylor. Une réponse de Merrheim », La Vie ouvrière, n° 116, 20 juillet 1914, pp. 103-111.
Ouvrages et brochures
Alphonse Merrheim, L’Organisation patronale. Syndicats, comités régionaux, ententes et comptoirs, assurance contre les grèves, Paris, Imprimerie La Libératrice, s.d. [1908], 29 pages.
Alphonse Merrheim, L’Affaire de l’Ouenza. À genou devant le Comité des Forges. La révision de la loi de 1810 sur les mines, Paris, Éditions de La Vie ouvrière, 1910, 64 pages.
Alphonse Merrheim, La Métallurgie. Son origine et son développement. Les forces motrices, Paris, Éditions de la Fédération des Métaux, 1913, 640 pages.
Alphonse Merrheim, Albert Bourderon, Pourquoi nous sommes allés à Zimmerwald, avant-propos à la Conférence socialiste internationale, Paris, Imprimerie de la Fédération des Métaux, 1915, 32 pages.
Alphonse Merrheim, La Conception du travail, Villeneuve-Saint-Georges, L’Union typographique, 1919, 45 pages.
Alphonse Merrheim, La Révolution économique, Paris, Imprimerie Georges Cadet, 1919, 34 pages.
Alphonse Merrheim, Amsterdam ou Moscou ? Le syndicalisme en danger, Paris, Éditions du Cerce d’études et d’action syndicales, 1921, 61 pages.
Cette liste a été établie par Nicholas Papayanis dans Alphonse Merrheim. The emergence of reformism in revolutionary syndicalism (1871-1925), pp. 174-176.
Pendant quinze ans, nous avions été, Merrheim et moi, mieux que deux camarades d’idées, nous avions été comme deux frères. Un jour, au lendemain de la guerre, nous étions devenus des frères ennemis. Dans la violence des discussions, qui ont déchiré le syndicalisme, j’ai souffert plus que personne de son égarement. Jamais je n’ai oublié l’homme qu’il était, ni qu’il s’était donné tout entier au mouvement ; jamais je ne l’ai méprisé. Il a pu être injuste pour nous, pour moi ; j’ai fait effort pour ne pas l’être envers lui. Et je suis bien sûr que ses nouveaux camarades, qui n’ont trouvé que de froides paroles à jeter sur sa tombe, ne l’ont pas compris et aimé comme nous l’avions aimé et compris.
Ils ne pouvaient parler que de la dernière période de sa vie, la moins glorieuse ; les autres périodes, celle de son apostolat de militant syndicaliste, celle des années de guerre où il a incarné la résistance ouvrière, nous appartiennent et ce sont elles qui dresseront sa grande figure dans l’histoire du mouvement ouvrier. Le père Bourderon ne pouvait pas l’avoir oublié, et il a eu le courage d’écrire dans le Peuple que l’attitude de Merrheim durant la guerre constituait la plus belle page de sa vie.
Les souvenirs de quinze années de vie côte à côte m’enveloppent et me serrent la gorge. J’avais fait sa connaissance presque à son arrivée à Paris, en 1904 ; ensemble nous avions mis debout la Vie Ouvrière d’avant-guerre et jusqu’en 1918 nous avions suivi le même chemin. Je le revois un après-midi de 1904, dans le bureau de Pages Libres où nous fîmes connaissance. Charles Guieysse l’avait invité à déjeuner ; il voulait recueillir les impressions faites par le milieu des militants syndicalistes parisiens de l’époque sur un ouvrier de province, abonné à Pages Libres, et devenu secrétaire de Fédération depuis un mois ou deux. La conversation engagée entre eux se poursuivit avec nous tous, au bureau. Guieysse m’avait d’ailleurs présenté comme le « syndicaliste » de l’endroit. C’était immédiatement un premier lien entre nous. Ce qui nous frappa tous, ce fut le sérieux, la timidité de Merrheim en présence de la tâche dont on l’avait chargé ; il ne disait pas, mais on sentait qu’il avait la crainte d’être inférieur à cette tâche et qu’il tendrait sa volonté tranquille d’homme du Nord à se rendre capable de l’accomplir.
A la fusion de la Fédération du Cuivre avec celle des Métaux, Bourchet était passé du secrétariat du Cuivre à celui des Métaux. Un jour, brusquement, Bourchet donna sa démission. Il fallait un autre militant du Cuivre pour lui succéder. On avait été chercher Merrheim à Roubaix. Après bien des hésitations, il avait accepté.
Quelques semaines après, survenait la fusillade de Cluses. Un secrétaire des Métaux devait partir sur-le-champ. Mais qui partirait ? L’un des militants ayant déjà l’expérience des grèves violentes ? Non, on envoya Merrheim. Voulait-on lui faire commencer son apprentissage ou bien l’écraser tout de suite sous le fardeau ? Le fardeau ne l’écrasa point ; à force de volonté il suppléa à son inexpérience et conduisit le mouvement mieux qu’un vétéran. Ses correspondances sur la grève, à la Voix du Peuple, frappèrent Pouget qui comprit, le premier peut-être, quelles qualités rares il y avait en ce petit homme timide, arrivé en redingote et à qui beaucoup ne ménageaient pas les railleries.
Après Cluses, ce furent les grèves d’Hennebont et de la Meurthe-et-Moselle. Les militants actuels de la métallurgie ne feraient pas mal d’aller rechercher dans le Mouvement socialiste de 1905 et de 1906 les monographies de ces grèves, modèles du genre, écrites par Merrheim.
Un volume des meilleures études données à droite et à gauche par Merrheim serait singulièrement utile ; ses premières monographies ne seraient pas les moins intéressantes.
Nul militant n’a plus appris dans les faits eux-mêmes que Merrheim. C’est en analysant son expérience des .grèves, qu’il a découvert la puissance du comptoir de Longwy et du Comité des Forges et qu’il les a révélés, peut-on dire, aux militants ouvriers. Il en tirait les conséquences pratiques au point de vue de l’organisation ouvrière : nécessité de renforcer la Fédération d’industrie des Métaux, d’y englober les diverses Fédérations de métier ; nécessité aussi de suivre pas à pas les agissements du patronat des Forges.
Personne n’a plus fait que Merrheim pour adapter le syndicalisme à la lutte contre le grand patronat moderne, pour faire dans l’ensemble du mouvement ce qu’il tentait dans la Fédération Métaux, pour reprendre et prolonger l’œuvre de Pelloutier, pour dissiper le verbalisme et réaliser l’organisation syndicale consciente de son rôle révolutionnaire. On lui a reproché sa phobie des « braillards ». Il l’avait en effet. Il était leur bête noire. Ils étaient la sienne. L’homme pondéré du Nord qu’il était resté, le travailleur acharné qui donnait 18 heures par jour à sa fonction, à ses idées, ne pouvait souffrir ceux qui se contentaient de discourir sur des lieux communs et qui étaient bien incapables de se colleter avec les réalités du régime capitaliste puisqu’ils ne cherchaient même pas à se les représenter.
En suivant pas à pas l’action du Comité des Forges, en s’efforçant de comprendre le monde économique, Merrheim fit une seconde découverte : il vit venir, dès 1910-1911, la guerre mondiale. Aujourd’hui, cela peut sembler banal. Ceux qui se souviennent savent qu’à l’époque personne en France en voyait venir la guerre. Je me rappelle de quels sarcasmes on accueillit son étude de la Vie Ouvrière sur « l’Approche de la Guerre ». Prophétiser la venue de la guerre, c’était même pour d’aucuns inoculer du pessimisme à la classe ouvrière.
On a dit et même écrit que Merrheim n’avait fait que répéter et recopier Delaisi. Il n’en est rien. Il a autant appris à Delaisi qu’il n’a appris de lui et ce qui est vrai c’est que tous deux, vers le même temps, d’observatoires différents, ont vu avancer la tempête formidable, que les spécialistes des questions diplomatiques, les grands économistes, les hommes d’État n’apercevaient pas.
Durant ces dix années, de 1904 à 1914, Merrheim a été un exemple de fonctionnaire, de militant syndical. Il n’a fait qu’un avec sa fonction ; il n’a pensé, travaillé, vécu que pour l’organisation, pour le mouvement. Personne n’a moins gaspillé son temps et ses forces ; personne n’a donné plus au syndicalisme. Grâce à son esprit méthodique et tenace, il trouvait le moyen d’abattre la besogne de plusieurs. Le petit chaudronnier de Roubaix était devenu la plus haute figure du mouvement syndicaliste français.
Il devait lui rendre encore un plus grand service quand la guerre vint bouleverser tout. Il l’avait annoncée, dans l’incrédulité générale. Quand elle fut sur nous, qu’elle dispersa et courba tout, qu’elle ouvrit les écluses de sang, il fut épouvanté comme nous. Les enfants qui osent comparer la guerre du Maroc à la guerre de 1914 ne savent ce qu’ils disent. On voit bien qu’ils ignorent ce qu’est un déferlement de guerre mondiale où des peuples entiers sont jetés les uns contre les autres. Les quelques individualités qui gardent les yeux ouverts sont alors comme affolées de la folie ambiante. Il devait trouver sa voie en septembre, quand le Bureau confédéral partait à Bordeaux dans le train gouvernemental. Une ombre avait passé entre nous à l’occasion du discours de Jouhaux aux obsèques de Jaurès ; il avait cru devoir à l’une des petites réunions du Comité confédéral, accepter le discours de Jouhaux. Mais il devait se ressaisir vite et c’est autour de lui que la poignée de résistants à la guerre se rassembla, d’abord dans notre petit logis de la Vie Ouvrière, dans ce 96, quai Jemmapes où se trouve la R.P., puis au Comité pour la reprise des relations internationales.
A mon retour à Paris, en octobre 1914, je m’étais mis en rapports avec Martov, qui venait de publier dans la Guerre Sociale une réponse à Hervé nous apprenant que tous les partis socialistes russes s’étaient prononcés contre la guerre. Martov, un jour de la fin 1914, nous amena Trotsky. C’est eux qui convoquèrent au quai Jemmapes la réunion des survivants français de l’internationalisme pour la venue de Grimm, qui préparait la première conférence internationale qui se tint seulement en septembre 1915 à Zimmerwald. Zimmerwald où l’honneur de la classe ouvrière et du socialisme français devait être sauvé par deux syndicalistes, Merrheim et Bourderon.
Tandis que Merrheim était porté plus particulièrement vers Martov, Rosmer et moi nous l’étions vers Trotsky. Puis, je fus mobilisé. Je ne revis plus Merrheim qu’à mes permissions de détente. Chaque fois, je le trouvais plus ulcéré par ce qui se passait dans le mouvement syndical. Comme Dumoulin, il était plus implacable que moi contre ceux qui prostituaient le syndicalisme dans l’union sacrée.
Mais la revanche de l’esprit révolutionnaire viendrait ; notre mouvement serait redressé ; les meilleurs se rangeaient autour de Merrheim. Pour la classe ouvrière il était le guide éprouvé. A ce moment il a personnifié, concentré tous les espoirs révolutionnaires de ce pays.
Pourquoi n’est-il pas resté ce qu’il avait su être en ces années terribles ?
Après le Congrès de Paris (1918), durant les derniers mois de guerre, Dumoulin m’écrivait au front : « II ne faut plus compter sur Merrheim ; quitte l’espoir de le ramener ; il est perdu pour nous ».
Je me refusais à l’admettre. Je pensais que lorsqu’il nous sentirait autour de lui il se ressaisirait. Hélas, quand je fus démobilisé, Merrheim était perdu pour nous en effet. Mais Dumoulin aussi. Mais Million encore allait s’éloigner de nous.
S’ils étaient restés, si nous nous étions retrouvés tous, les résistants de la première heure, avec quelle facilité le syndicalisme français se serait redressé sans se briser.
Comment Merrheim, qui avait traversé les épreuves les plus dures, a-t-il pu faiblir un jour ? Je me suis torturé l’esprit pour trouver une explication.
Le fardeau a-t-il fini par l’écraser ? La lassitude l’a-t-elle pris un jour ? Le manque de foi dans les destinées de la classe ouvrière ?
Pour une part, j’attribue son éloignement à son entourage, à Paul Meunier, à Dulot, à Hoschiller. Par ceux-là la bourgeoisie nous l’a volé sans qu’il s’en rendît compte. A fréquenter des bourgeois intelligents, même quand ils sont honnêtes, un militant ouvrier glisse à regarder les problèmes non plus du point de vue de classe, mais du point de vue opposé de ces bourgeois ; il ne regarde plus avec des yeux d’ouvrier. Merrheim en arriva à ne plus reconnaître son mouvement et à ne pas voir tout ce qui nous lie à la Révolution russe.
Ses collègues des Métaux ont leur part de responsabilité. Lenoir a dit à Roubaix sur la tombe de Merrheim qu’ils l’avaient soutenu, aidé à grandir.
Ils l’ont abaissé, oui.
Le Merrheim qui fut grand, qui nous domina tous, qui restera dans l’histoire de notre mouvement, c’est d’abord celui qui fut un modèle de militant syndicaliste de 1904 à 1918, c’est enfin et surtout celui qui alla à Zimmerwald.
Ses dernières années ne peuvent faire oublier tout ce qu’il fut pendant quinze ans.
Tirée de Pierre Monatte, « Alphonse Merrheim (1871-1925) », La Révolution Prolétarienne, n° 11, novembre 1925, pp. 11-12. La retranscription de cet article est disponible en ligne : http://www.pelloutier.net/glossaire/detail.php?id=3.
Évolution des effectifs de la Fédération de la métallurgie (1909-1921)
| Année | Effectif (moyenne à 9 timbres) |
| 1909 | 19 200 |
| 1910 | 26 111 |
| 1913 | 36 111 |
| 1914 | 19 444 |
| 1915 | 1 444 |
| 1916 | 6 888 |
| 1917 | 68 888 |
| 1918 | 139 668 |
| 1919 | 201 547 |
| 1920 | 94 283 |
| 1921 | 77 333 |
Évolution des grèves dans la métallurgie (1901-1919)
| Années | Nombre de grève | Ouvriers concernés |
| 1901-1903 | 26 | 2 894 |
| 1903-1905 | 60 | 10 302 |
| 1905-1907 | 114 | 5 857 |
| 1913 | 139 | 23 335 |
| 1914 | 73 | 16 009 |
| 1915-1918 | – | 95 004 |
| 1919 | – | 329 242 |






