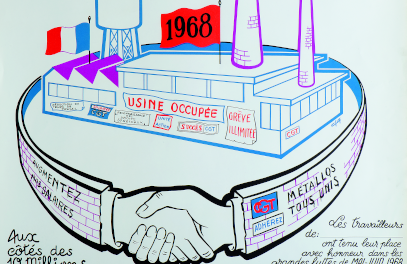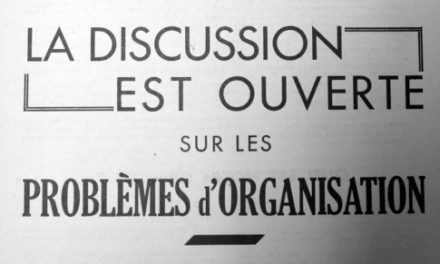Hubert Doucet, ancien secrétaire général de l’Institut CGT d’histoire sociale de la métallurgie, vient de déposer ses archives. Un document a plus particulièrement retenu notre attention. Il s’agit d’un témoignage écrit de Serge Antoine, rédigé en 2009, sur son activité professionnelle au sein de la policlinique des métallurgistes et sur sa rencontre avec le docteur Pierre Rouquès. Il évoque, comme vous allez pouvoir le lire ci-après, les actions de solidarité médicale assurée par l’équipe de la policlinique.
Cette découverte a été l’occasion de rédiger et de mettre en ligne la biographie de Serge Antoine sur le site internet du Maitron, que vous pouvez lire à l’adresse suivante : https://maitron.fr/spip.php?article248996.
Le docteur Pierre Rouquès
« Je suis un ancien de la policlinique engagé pour assurer le poste de responsable des admissions des hospitalisés et des malades venant consulter. C’était en janvier 1950 et le directeur était notre camarade Bompays[1].
Quelques temps après mon arrivée, le docteur Pierre Rouquès[2] me demanda de venir voir à son cabinet. Je ne l’avais pas encore rencontré. Pour moi, cela donnait déjà un début de son style de travail. Connaître toute personne responsable était sa manière de travailler. Bien qu’étant ʺadministratifʺ, il n’affichait pas vis-à-vis des catégories non-médicales le mépris que l’on rencontre souvent dans ce milieu. Jeune cadre inexpérimenté, qui a tout appris sur le tas, cette attitude m’a rassuré presque instantanément. Car travailler avec un tel homme devenait pour moi l’assurance que mon travail serait facilité. Effectivement, par tous ses conseils, j’ai vite appris ce que je devais donner pour la policlinique. Regarde, me disait-il, au-dessus des guichets, cette longue plaque de verre, c’est là que tu trouveras la signification de cette policlinique. Il était peint dessus : ʺLe syndicat, c’est la solidarité et la fraternité. Benoît Frachonʺ. Tout un programme !
J’avais en face de moi, non seulement, un homme de l’art médical, bâtisseur de centres de santé, un ancien des Brigades internationales en Espagne, mais un militant. Et moi, jeune militant aux Jeunesses communistes (JC) depuis 1935, syndiqué en septembre 1936, résistant arrêté en 1943, déporté en Allemagne nazie[3], j’étais transporté de joie de voir cet homme si haut dans les responsabilités qui m’abordait avec tant de modestie et de simplicité.
Il me donnait une autre idée de ce que doit être la responsabilité.
Il savait être amical et ferme quant il le fallait. Lorsqu’il arrivait à la policlinique, il saluait tout le monde, des femmes de service en passant par les employées administratives. Ce n’était pas le ʺchefʺ, c’était l’homme responsable, respectueux de celles et de ceux qui assuraient la bonne marche de la policlinique. Il me disait, lorsque de service à l’hôpital public passaient en premier auprès de lui les victimes des forces de police matraquées au cours des manifestations, les policiers blessés passaient après : ʺles victimes d’abordʺ disait-il.
Il était à cheval sur l’égalité entre les individus. Cela me rappelle : faisant devant le personnel son rapport sur ce qu’il avait vu au cours d’un voyage médical en Union soviétique, il nous raconte un incident survenu au cours d’une réception : son chauffeur russe qui l’accompagnait toujours et partant, ne peut pénétrer ce jour-là à cette réception ; ce qui le mit très fort en colère, mais dut accepter cette décision, cette situation, qu’il considérait comme une attitude méprisante. À mon avis, c’était très discutable cette attitude du docteur Rouquès ! Mais c’était lui, l’homme qui voyait cela comme une inégalité.
Il était attentif à tout : en visite auprès de ses patients hospitalisés en service chirurgie, il s’aperçut que les murs étaient éraflés par les chariots de linge : il en fit la remarque à la surveillante : ʺVous auriez du le voir avant moi, faites le nécessaire ce qui fut fait quelques jours plus tardʺ.
Pointilleux sur la propreté, comme cela se comprend : en passant la main sur un meuble, il la retira pleine de poussières : ʺMadame la surveillante, je ne veux plus voir celaʺ.
Pointilleux sur l’exactitude des médecins à leurs consultations. Et sa grande amie, le docteur Lagrange, ophtalmologiste, il lui dit : ʺMa chère amie, vous savez que je vous aime bien, mais il me semble que vous devez pour vos patients arriver à l’heure.ʺ
Toutes ses remarques étaient faites avec une extrême gentillesse, pour éviter des blessures d’amour-propre. Ce n’est pas toujours facile d’allier fermeté et gentillesse avec un visage sévère.
Je me suis marié en 1951[4], mais sa charge de travail l’empêcha d’être présent. Il m’envoya un gentil petit mot que je conserve depuis si longtemps en pensant à lui.
Quelques temps après, il nous quittait[5]. Les obsèques grandioses et très fraternelles l’enlevait à tous ses amis. Il fut suivi par d’innombrables personnes de tous les horizons. Les amis, confrères, des ouvriers des usines, des bureaux, des syndicats CGT, de l’Union des syndicats CGT des travailleurs de la métallurgie particulièrement, des élus du Parti communiste français, du personnel de la policlinique des dizaines de bonnes sœurs en cornette à cette époque, fait rarement vu au cours d’obsèques d’un communiste. Cela donnait à cet adieu grandiose la mesure de la notoriété de l’homme, du chirurgien, du militant communiste, du résistant qu’il fut.
Voilà ce que je peux dire du militant dont j’avais entendu parler durant la guerre d’Espagne, sur son rôle pendant la Résistance, également au conseil municipal de Paris, sur le militant que j’ai eu l’honneur et le bonheur de rencontrer à la policlinique en 1950.
La solidarité en actes
La solidarité était l’objet de soins quotidiens, sous tous les aspects parfois très différents l’un de l’autre. Le docteur Pierre Rouquès a laissé une empreinte très forte, très longtemps après sa mort.
Je n’étais à la policlinique que depuis le début 1950, et je n’ai connu cet aspect de solidarité que d’après celles et ceux qui étaient là dès l’ouverture. La policlinique a vécu des moments difficiles financièrement. Il fallait faire des sacrifices sur les salaires et sur tous les aspects vitaux de la policlinique. Par exemple, les premiers à la réouverture me dirent qu’il n’était pas rare de voir médecins, infirmières, administratifs, femmes de service faire un stage à la cuisine pour y éplucher les pommes de terre, gratter les carottes, équeuter les haricots pour aider à la confection des repas des hospitalisés et du personnel. Et j’en oublie… la mémoire flanche ! Il fallait que la policlinique fonctionne, l’état d’esprit du docteur Pierre Rouquès avait profondément marqué le comportement des gens.
Mais la vie tend à se normaliser, cette forme de solidarité fut efficace jusqu’en 1948, début 1949. Elle prit d’autres formes, plus profondes, plus responsables. Avec l’éviction des ministres communistes du gouvernement en 1947, de grandes grèves eurent lieu et bien sûr une énorme répression, notamment en novembre-décembre 1947. Des blessés par dizaines, puis par centaines, victimes des affrontements avec la police trouvèrent à la policlinique, œuvre syndicale des métallurgistes, un lieu de solidarité et de fraternité pour y recevoir des soins. Les manifestants le savaient et cela supposait pour nous, policlinique, de prendre des mesures pour répondre aux besoins, à chaque manifestation prévue. Le docteur Pierre Rouquès accomplit là un très grand acte de solidarité, en s’adressant à ses confrères et aux personnels pour que chacun soit à son poste. Tout le monde accepta, sans exceptions, communistes ou pas. Les surveillants de l’époque organisaient les accueils médicaux (matériel de soins, médicaments, etc.) et dirigeaient les blessés vers tel ou tel médecin qui était accompagné par une infirmière. Se cotoyaient médecins généralistes, chirurgiens, médecins accoucheurs, oto-rhino, etc. Tous ceux qui répondirent à l’appel étaient présents et ce, bénévolement. Ainsi, à chaque manifestation prévue, cette organisation était impérativement tenue. Du rez-de-chaussée, les secrétaires administratives qui recevaient en premier lieu les blessés accompagnaient ceux-ci au lieu des consultations au premier étage, où les attendaient ʺle bataillon des médicauxʺ.
Un souvenir personnel, lors d’une manifestation contre la Communauté européenne de défense (CED) en 1952, c’est moi qui a monté dans mes bras Belaïd Hocine auprès des médecins, malheureusement tué par la police[6].
Chaque année affronta des situations de ce genre, 1956 au moment du saccage du siège du PCF, 1957, 1958, 1959, et le 8 février 1962. Cela dura pendant des années, chaque fois que la police se montra aussi odieusement brutale. L’esprit de solidarité développé par le docteur Pierre Rouquès était d’une très grande efficacité.
Elle se manifesta aussi en direction de nos camarades espagnols clandestins. J’étais chargé de m’occuper de les faire suivre médicalement par nos médecins, de 1960 jusqu’en 1976.
Puis en même temps que s’effectuaient les actes de solidarité, j’avais en charge de m’occuper des ʺenfants de nos camarades fusillésʺ dans les premières années qui suivaient la capitulation nazie en 1945. Cet organisme, ʺvacances aux enfants de fusillésʺ envoyaient ces jeunes pendant un mois en vacances, et notre contribution consistait à faire passer la visite de dépistage et de non-contagion. Là aussi, les mêmes personnes que pour les soins aux blessés assuraient bénévolement cette tâche humaine qui s’effectuait le dimanche matin. J’en avais la responsabilité par les directions successives de la policlinique. Des centaines et des centaines d’enfants de fusillés bénéficieront pendant plusieurs années de la solidarité de la policlinique. Les enfants grandirent et bien entendu cette action solidaire aussi. Une action nouvelle de solidarité remplaça les ʺenfants de fusillésʺ. Cette nouvelle activité très ʺrégion parisienneʺ s’appelait le ʺbol d’air des gamins de Parisʺ, réservée aux enfants nécessiteux. Cette action, bénévole, de solidarité, bénéficia de la structure élaborée pour les soins aux blessés. Elle assura les visites de dépistage et de non-contagion de 1960 à 1976 chaque dimanche de juin à fin juillet, avec environ 200 enfants à chaque séance. Des milliers d’enfants durant toutes ces années, de 1945 à 1955 pour les enfants de fusillés et de 1960 à 1976 pour le ʺbol d’airʺ ont été accueillis par la solidarité de la policlinique avec ses médecins, ses personnels non-médicaux et administratifs.
Cet effort, hautement apprécié, démontre que la solidarité et la fraternité, mises en place en son temps par le docteur Pierre Rouquès, a été une activité qui a envahi la vie syndicale des Unions des syndicats des travailleurs de la métallurgie de la région parisienne et la vie de centaines de personnes. Les salariés de la policlinique peuvent être fiers du sens qu’ils ont donné à ces simples mais nobles mots : solidarité et fraternité. »
Serge Antoine
[1] Henri Bompays a été le directeur de la policlinique des métallurgistes de septembre 1949 à avril 1951, après avoir été en 1948 le secrétaire général de la société anonyme propriétaire de la Maison des Métallurgistes, au 94 rue Jean-Pierre Timbaud à Paris (11e arr.).
[2] Une biographie est en ligne sur le site du Maitron : https://maitron.fr/spip.php?article129851.
[3] Le 8 mai 1943, il est déporté, sous le numéro de matricule 66 115, au camp de concentration de Sachsenhausen (Allemagne), dans le Kommando Heinkel, un camp de concentration dédié à l’usine de construction aéronautique. Il est rapatrié le 4 mai 1945 de Crivitz (Allemagne).
[4] Il a épousé Ginette, André Mignot le 30 juin 1951 à la mairie du treizième arrondissement de Paris.
[5] Pierre Rouquès est décédé le 19 avril 1952 à Créteil (Val-de-Marne). Inhumé le 23 avril au cimetière du Père-Lachaise à Paris (11e arr.), il partage sa sépulture avec Ambroise Croizat, secrétaire général de la Fédération et ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
[6] Hocine Belaïd est tué à l’occasion de la manifestation du 24 mai 1952 contre la venue à Paris du général Ridgway, commandant suprême de l’OTAN et non, comme Serge Antoine l’évoque, lors d’une manifestation contre la CED.