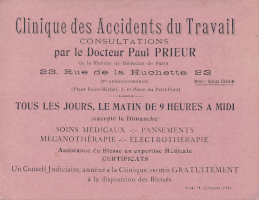Les archives de la Préfecture de police de Paris, dont les locaux se situent au Pré-Saint-Gervais en Seine-Saint-Denis, conservent parmi leurs rayonnages un épais dossier, sous la cote Ba 131, au sujet d’une longue grève menée durant l’hiver 1909-1910. L’établissement ciblé par le conflit est aujourd’hui bien connu des métallurgistes, notamment ceux de la région parisienne. Il s’agit de l’usine Couesnon et Cie, une fabrique d’instrument de musique en cuivre, située dans le onzième arrondissement de la capitale, au 94 rue d’Angoulême devenue, depuis octobre 1944, la rue Jean-Pierre Timbaud.
Cette manufacture fut acquise par les syndicats de la métallurgie de la région parisienne à la toute fin de l’année 1936, grâce à la vague d’adhésions nouvelles accompagnant les luttes du Front populaire. Inaugurée le 2 mai 1937, au lendemain d’une journée de grèves et de manifestations d’une ampleur inconnue jusqu’alors, la « Maison des Métallurgistes » est immédiatement devenue l’un des hauts-lieux du syndicalisme de la région parisienne et, au-delà, une adresse familière pour tous les travailleurs. Siège social, le « 94 » comme on l’appelle affectueusement, est bien évidemment un lieu de réunions, de formation et de diffusion des valeurs et revendications syndicales, mais il accueille également une caisse primaire d’assurance maladie, une mutuelle, un conseil juridique, un cabinet de dentiste, une librairie, une salle de musique ou encore une cantine.
Si l’histoire du « 94 » est bien connue, celle des ouvriers en instruments de musique parisiens et de leurs luttes avant la Première Guerre mondiale l’est beaucoup moins, d’où cette modeste contribution !
Les instruments de musique à Paris
Malou Haine, dans sa magistrale étude Les facteurs d’instruments de musique à Paris au XIXe siècle. Des artisans face à l’industrialisation, paru en 1985, dépeint l’évolution économique et sociale de cette branche rattachée de la métallurgie. Les manufactures parisiennes d’instruments de musique subissent une véritable hécatombe durant le dernier quart du XIXe siècle. Entre 1872 et 1896, le nombre de patrons passe ainsi de 679 à 224, se répartissant de la manière suivante : 105 facteurs de pianos, 62 luthiers et facteurs d’instruments à vent, 31 facteurs d’orgues, 25 facteurs d’instruments à vent en cuivre. Dans le même temps, on observe une tendance à l’augmentation de la taille moyenne des entreprises, dans ce secteur qui regroupe en 1896 près de 3 500 ouvriers et employés.
Ces éléments statistiques, établis par l’Office du Travail, ancêtre du ministère du même nom, ne sont pas exempts d’erreurs, mais il donne une idée du contexte économique dans lequel l’entreprise Gautrot, basée à Château-Thierry et installée dans le quartier parisien du Marais après avoir repris en 1845 la maison Guichard, décide en 1881 de la construction d’une nouvelle usine, dans le onzième arrondissement. Thomas Le Roux en relate l’histoire, dans son article « Le patrimoine industriel à Paris, entre artisanat et industrie » paru dans Le Mouvement social. Située au 94 rue d’Angoulême, cette manufacture rassemble sous sa grande halle métallique surmontée d’une verrière, une petite centaine d’ouvriers très qualifiés ainsi qu’une machine à vapeur, dans un environnement rationnalisé, mais peu mécanisé.
En 1882, Pierre Gautrot décède et son gendre, Amédée Couesnon reprend l’entreprise dont il est déjà le gérant. L’entreprise est florissante et elle procède, sous sa direction, à plusieurs augmentations de capitaux ainsi qu’au rachat de plusieurs facteurs en instruments de musique. Elle emploie, à son apogée durant l’entre-deux-guerres, plus d’un millier de salariés répartis dans cinq usines en France. Amédée Couesnon s’engage également en politique. Radical-socialiste, il est député de l’Aisne de 1907 à 1924 et conseiller général de 1910 à 1931, année de son décès.
Le précédent de novembre 1881
Les grèves sont rares dans les factures instrumentales. Malou Haine n’en recense que dix, entre l’adoption de la loi Ollivier le 21 mai 1864 autorisant, de manière très encadrée, le droit de grève et la fin du XIXe siècle. Trois concerne les ouvriers en instruments de musique à vent en cuivre, dont une mobilise l’ensemble de la profession. Ainsi, le 3 novembre 1881, la toute jeune Chambre syndicale ouvrière des facteurs d’instruments à vent, créée en mars de la même année, mandate deux membres de sa commission exécutive pour soumettre la revendication d’augmentation de 20 % des salaires à l’un des patrons, Mille, établit dans le Xe arrondissement. Ce dernier refuse d’accéder à cette demande, et la grève débute, unanime.
Elle se déclenche alors qu’une grève est en cours depuis septembre parmi les facteurs de pianos, là encore pour réclamer une hausse des salaires de 20 %, mais également pour obtenir une réduction de la durée journalière du travail, la suppression complète du marchandage (voir Les Cahiers d’histoire sociale de la métallurgie n° 63 sur ce sujet) ou encore la suppression, pour l’ouvrier, de l’obligation de fournir certaines matières premières telles que pierres ponces, chiffons, éclairage, huile, etc.
Le patronat des instruments à vent, solidaire avec Mille, décide le renvoi des ouvriers syndiqués qui soutiennent la grève par leurs cotisations, soit potentiellement 600 ouvriers, la moitié des effectifs de la profession ! Seuls les établissements Gautrot, dont le gérant est alors Amédée Couesnon, et Sudre refusent de suivre cette proposition. Les ouvriers se prononcent alors pour la « résistance à outrance », mais, après trois semaines de lutte, les caisses sont vides et les défections nombreuses dans les rangs des grévistes. La solidarité, importante à l’image des 400 francs versés par les ouvriers de chez Gautrot épargnés par les renvois, n’a pas suffit à faire plier le patronat et la grève s’achève sur un échec.
Six semaines de grève
L’agitation ne repris que bien des années plus tard, durant la première décennie du XXe siècle, dans un contexte marqué par la crise de la CGT et le congrès d’unité de la Fédération de la métallurgie en mai 1909, comme nous avons pu l’aborder à l’occasion du débat précédant le repas des anciens en février dernier.
Le 12 octobre 1909, L’Humanité reproduit un appel lancé par la Chambre syndicale des ouvriers en instruments de musique (cuivre et bois) de Paris – dont le secrétaire est Édouard Soffray – pour dénoncer la division ouvrière, les bas salaires et les conditions de travail dans cette branche. Déterminée à mettre un terme aux diminutions de salaire, elle revendique l’établissement d’un tarif général qu’elle soumet aux entreprises. Début décembre, la Chambre présente un cahier de revendications à l’ensemble des patrons de la corporation et ceux-ci n’ayant pas fait droit, une grève éclate le lundi 7 décembre dans l’une des principales, Couesnon et Cie.
La grève est unanime et les revendications portent sur l’amélioration des conditions de travail, un salaire minimum, la suppression du travail aux pièces. Après en avoir reconnu le bien-fondé, Amédée Couesnon fait brusquement marche arrière et refuse que la Chambre syndicale appose sa signature au bas de la convention établissant les conditions nouvelles de travail. Le 12 décembre, une affiche est apposée à la porte des ateliers, avisant les ouvriers grévistes qui ne reprendront pas leur travail qu’ils seront considérés comme « démissionnaires ».
Cette attitude lui vaut d’être vertement tancé dans L’Humanité par Édouard Soffray qui ne manque pas de rappeler que ce patron se présente volontiers comme un philanthrope, doué d’« une sympathie sans égal » pour ses ouvriers et le syndicat. Le 15 décembre, Amédée Couesnon n’ayant pu obtenir la reprise par l’intimidation, « fait savoir que ses ouvriers peuvent reprendre le travail et qu’il leur paiera les jours passés à faire grève sur l’invitation du syndicat. » De nouveau, la Chambre syndicale réplique : « L’accord pourra se faire lorsque M. Couesnon aura donné, comme garantie des revendications accordées, la signature que des patrons moins libéraux qu’il prétend être donnent au bas des contrats de travail présentés par le syndicat. […] Il y a peut être de l’orgueil de la part du syndicat à vouloir traiter d’égal à égal avec un patron et de prétendre que la signature du représentant du syndicat a autant de valeur que celle d’un patron. Mais c’est là une prétention dont M. Couesnon devrait être le dernier à trouver abusive, lui qui prétend être un républicain syndicaliste. » Le bras de fer engagé entre les 150 grévistes et la direction se poursuit donc.
Amédée Couesnon adresse alors une lettre au directeur de L’Humanité, reproduite dans son édition du 24 décembre, dans laquelle il présente le niveau des salaires pratiqués dans son usine parisienne, pour dix heures hebdomadaires. Les ouvriers bénéficient également d’une retraite annuelle de 250 francs pour vingt-cinq ans de présence et de 360 francs pour trente ans, sans versement ouvrier. Édouard Soffray réplique dès le lendemain. Il maintient que des ouvriers adultes, finisseurs en instruments, perçoivent des salaires ne dépassant pas cinq francs par jour. Les chiffres avancés par Amédée Couesnon sont ceux de novembre, un mois de 29 jours ouvrés durant lequel les ouvriers ont travaillé onze heures par jour, ainsi que les quatre matinées du dimanche, ce qui fausse les salaires annoncés. Pour ce qui est de la retraite, il est pointé le faible nombre d’élus et la nécessité, pour en bénéficier, de donner des gages de loyalisme.
Les fêtes de fin d’année n’entame que peu la détermination des grévistes, dont le nombre n’a été diminué que d’une douzaine. Dans son rapport mensuel de décembre 1909, la préfecture de police de la Seine signale : « il ne s’est produit de grève importante pendant le mois de décembre que celle des ouvriers de la maison Couesnon et Cie […]. 170 ouvriers sont en grève depuis le 7 décembre et réclament leur augmentation de salaire et la signature d’un contrat collectif de travail. » Amédée Couesnon accepte les nouvelles conditions pour les salariés actuels, mais refuse toujours de le garantir pour les futurs embauchés. Le 6 janvier 1910, L’Humanité signale que deux grévistes ont été arrêtés, avant d’être remis en liberté provisoire sur l’intervention du député du Nord Pierre Mélin, ancien ouvrier en instrument de musique et père de l’un des grévistes.
Le 18 janvier, plusieurs journaux, comme L’Action ou Le Petit Parisien, annoncent la fin d’une grève de six semaines. Les grévistes obtiennent un tarif minimum horaire représentant, de fait, une augmentation des salaires journaliers de 1 à 1,5 franc par jour. La majoration des heures supplémentaires et la suppression du travail aux pièces ont été rejetées. La reprise s’effectue le 23 janvier, avec la promesse qu’aucun renvoi pour faits de grève ne serait fait. Pour autant, fin janvier, tous les salariés n’avait pas encore été repris.
Une grève payante
Ces six semaines de grève chez Couesnon s’achèvent sur une « demi-satisfaction » pour les salariés. La principale revendication, celle de la signature d’un contrat collectif, n’a pas abouti. Mais, cette lutte n’a pas été inutile, car elle a fait des émules.
Le 29 janvier 1910, un conflit est déclenché à la maison Besson-Fondère, au 96 rue d’Angoulême, tandis que L’Humanité annonce des victoires à la maison Vion, rue du Château-Landon (10e arr.), chez Evette et Schaeffer, passage du Grand-Cerf (2e arr.) ou encore chez Sudre, boulevard de Rochechouart (18e arr.). Chez ce dernier, les salariés obtiennent une augmentation de salaire de 1 à 1,5 franc par jour et l’amélioration des conditions de travail, le tout sans grève !
La quasi-totalité des entreprises de la corporation ont finalement accepté les hausses, exception faite de Besson-Fondère et de la maison Millereau, au 66 rue d’Angoulême, dont le patron, M. Schoenaers, n’est autre que le président de la Chambre patronale. Dans ces deux entreprises, la grève dura et l’absence de mention dans la presse ouvrière laisse supposer que la victoire n’a finalement pas pu y être obtenue.
S’ils n’ont pas réussi à inscrire dans le texte un tarif général fixant les rémunérations dans toutes les entreprises de la profession, les ouvriers ont malgré tout réussi, par la grève, à obtenir une augmentation des salaires. La solidarité témoignée à cette occasion, par l’octroi de secours financiers et le respect de la mise à l’index des entreprises, ainsi que le rejet de la politique paternaliste menée par de nombreux patrons font de cette grève un temps fort de l’histoire des ouvriers en instruments de musique de la région parisienne.