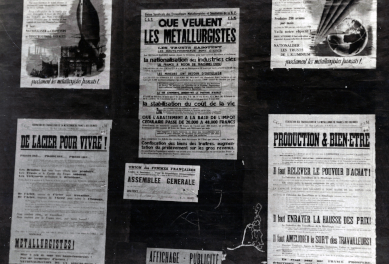Ce texte reproduit l’intervention prononcée par Claude Ven, président de l’Institut CGT d’histoire sociale de la métallurgie, devant l’assemblée générale des retraités métallurgistes à Toulouse le 28 janvier 2016.
Le 70e anniversaire de l’ordonnance qui créa la sécurité sociale fut l’occasion de nombreuses commémorations.
La CGT y a tenu toute sa place. Notamment grâce au travail accompli par le comité d’honneur Ambroise Croizat, animé par Bernard Lamirand.
Vous m’avez sollicité pour intervenir à l’occasion de cette assemblée. Au nom de notre IHS, je vous en remercie.
J’apporterais donc quelques éléments, repères et éclairages en m’appuyant sur le travail des camarades de la CGT.
Notre sécurité sociale n’a pas émergé du néant un beau matin de 1945. Elle est le fruit d’un long cheminement.
Il y eut auparavant de multiples systèmes de protection sociale, en France et ailleurs, à l’efficacité diverse et souvent discutable.
Il n’est pas inutile de les rappeler, sans pour autant inscrire la Sécurité sociale dans la simple continuité des systèmes antérieurs. C’est d’ailleurs une thèse régulièrement développée pour en réduire la portée et le caractère novateur.
S’il est évident que la sécurité sociale ne pouvait s’établir sans tenir compte de l’existant, sa conception, fondamentalement différente, a profondément bouleversé l’approche du problème de la protection sociale.
Les ressorts qui animent les individus sont identiques au fil des millénaires. De la grotte au village, l’histoire de l’humanité, si elle paraît se confondre parfois avec des destins individuels, est avant tout une histoire collective. L’évolution de la civilisation confrontera très vite l’individu à un environnement ou la famille et le clan ne sont plus en capacité d’assurer une protection suffisante.
Le monde du travail imaginera dès le moyen-âge, le système des corporations et du compagnonnage. Mais ces dispositifs, avec ses travers et ses perversités, ne permettront pas d’échapper réellement à une logique d’exploitation.
L’idée d’une protection sociale des travailleurs et de leurs familles est déjà dans les têtes lorsque la révolution de 1789 éclate.
Mais c’est avec la révolution industrielle que les aspirations se sont transformées en nécessités vitales. L’évolution technique et technologique, les exigences de productivité, la nature du travail et les conditions de son exercice ont accentués les difficultés des travailleurs. L’usure physique et mentale est de plus en plus précoce. Les accidents et maladies progressent en nombre et en gravité. Dès lors surgissent des besoins en matière de couverture de la maladie, de la vieillesse et du chômage.
Les premières réponses pour soulager les peines et les souffrances viendront de l’église. Celle-ci développe des institutions charitables. Mais elles sont loin d’être à la hauteur du problème. Si elles tentent de soigner les conséquences de l’exploitation, elle ne la remette pas en cause et n’ont pas vocation à la contester. A terme, elles ne débouchent que sur le développement du fatalisme en cultivant l’acceptation.
Quelques tentatives, isolées, d’épargne de précaution, verront le jour. Mais, réalisées au prix de lourdes privations et compte tenu de la faiblesse des salaires et des aléas économiques et sociaux, elles sont vouées à l’échec.
Il faudra que la classe ouvrière grandisse, qu’elle prenne conscience de ses intérêts, qu’elle commence à s’organiser pour que la solidarité s’impose comme la seule voie possible pour passer à un stade plus développé de réponse à ses besoins.
Face à la charité aléatoire se substitue alors, peu à peu, des dispositifs de solidarité organisée. Cela se traduit par l’apparition des caisses de mutuelles.
Les mutuelles ont une particularité, celle d’être aussi des lieux de rencontre, d’échange et de réflexion. Bientôt s’y organise la résistance à l’exploitation capitaliste, à l’image de la révolte des canuts, à Lyon, en 1831. C’est le syndicalisme qui s’ébauche. Mais il faudra attendre encore un demi-siècle, avant qu’il ne soit autorisé, en 1884.
Le patronat n’est pas dupe de ce qui se construit et prend forme.
Pour contrer ces premières solidarités organisées il investit le terrain de la réponse aux besoins. Il créé ses propres « œuvres sociales » dans le cadre du « patronage » avec la perspective d’une intégration des travailleurs aux logiques et aux impératifs du capitalisme.
Cette idéologie est surtout mise en place dans les grandes entreprises comme Schneider au Creusot ou de Wendel à Joeuf. L’enjeu est de s’assurer une « main d’œuvre stable et dévouée à l’œuvre commune », maintenue sous la pression patronale.
Dans le domaine de la famille, certains patrons, adeptes de la doctrine sociale de l’Église, seront à l’origine des allocations familiales. Dès 1880, quelques entreprises, ainsi que la fonction publique, versent des suppléments familiaux. Il faudra attendre les lois de 1932 et 1938 pour que cette politique familiale prenne un caractère général et connaisse un réel impact sur le taux de natalité.
Au XIXe siècle se développent de nombreuses caisses mutuelles. Sous le second empire, Napoléon III, qui se prétend sensible à la question sociale, s’empare de celles-ci. Sous couvert de l’aide de l’état, il place à leur tête des hommes chargés d’en réduire la portée et d’en museler les ambitions. C’est un tournant pour le mouvement mutualiste. Cette récupération maintiendra la défiance des ouvriers et futurs syndicalistes vis-à-vis des caisses mutuelles et des gouvernements sur les questions sociales. Il faudra la grande boucherie de la guerre de 1914, pour que, devant l’ampleur des besoins en terme de santé, de protection sociale des anciens combattants et de leur famille, la collectivité nationale se retourne vers l’état, seul acteur à la dimension.
C’est en Allemagne, que s’ébauche, au cours des années 1880, un projet de sécurité sociale moderne.
Le chancelier Bismarck, vainqueur de la guerre de 1870 contre les Français, émet l’idée que l’État doit avoir la mission de « promouvoir positivement, par des institutions appropriés et en utilisant les moyens de la collectivité dont il dispose, le bien-être de tous ses membres et notamment des faibles indigents ». En vérité, plutôt que d’assurer le mieux-être des travailleurs, il s’agit de contrecarrer le rôle grandissant du mouvement ouvrier.
En France, au début du XXe siècle, le mouvement mutualiste connaît un âge d’or et se développe sous de multiples formes, surtout d’essence patronale. Toutefois, il ne parvient pas à répondre aux besoins de manière satisfaisante.
Dans l’entre deux guerres, deux situations vont s’inscrire dans la réflexion. L’exemple de la mise en place, dès 1923, en Union Soviétique, d’un nouveau modèle de système de santé, fonctionnarisé, financé par l’état et géré par les syndicats. Et le maintien du système de protection sociale de Bismarck, en Alsace et en Moselle, territoires annexés par l’empire allemand de 1870 à 1918. Le gouvernement de l’époque n’hésite pas à se déclarer décidé à « y puiser des éléments susceptibles d’améliorer nos propres lois et de donner des avantages nouveaux à l’ensemble des travailleurs français ».
Cela n’empêchera pas les parlementaires de nier le besoin d’intervention publique dans le domaine social. On préfère laisser le champ libre aux patrons.
Néanmoins, sous la pression ouvrière, à force de lutte et d’acharnement, les premières assurances sociales voient le jour en 1928.
Cette réponse est loin d’être parfaite. Elle est à l’image de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes qui les a précédé en 1910. Une loi aussitôt appelée « retraite des morts » par la CGT. En effet, pour une population dont l’espérance de vie atteint difficilement la cinquantaine, elle n’ouvre droit à une pension qu’à partir de 65 ans. Les syndicalistes révolutionnaires lui reprochent également de reposer sur des principes de capitalisation et d’être en partie gérée par les mutualistes.
Ces assurances sociales, dont le projet, mit en chantier dès 1921, ne sera voté que sept ans plus tard, devront attendre encore deux ans avant de prendre effet à la date du 1er juillet 1930. Neuf ans ! Neuf années qui témoignent de l’intensité de la bataille politique, à laquelle participe activement les mutualistes, contre un système qui est pourtant loin d’être révolutionnaire.
En effet, les prestations maladie ne sont constituées que par des indemnités journalières égales à 50 % du salaire et acquises seulement au bout de 6 jours de carence ; mêmes bases pour la maternité ; l’invalidité, elle, ne donne lieu à pension que pour une incapacité des 2/3 et le capital décès est très faible.
La bourgeoisie a cherché des « réponses » au moindre « coût ». Ce qui explique le caractère ambigu et très incomplet de ces assurances sociales qui ne couvrent que les salariés de l’industrie et du commerce qui ont des salaires inférieurs à un certain montant. De plus, les accidents du travail, chasse gardée des assurances privées, restent en dehors de son champ d’application.
Cette médiocre réponse, a minima, sera toutefois appréciée positivement par Léon Jouhaux, dirigeant de la CGT. À l’inverse, Benoit Frachon de la CGTU, la critiquera et s’opposera longtemps au principe de la cotisation ouvrière.
Aux États-Unis, dès 1935, le président Roosevelt fait voter le Social Security Act, une amorce de système partiel de protection sociale en matière de vieillesse et de chômage. Son idée : « libérer du besoin » la population.
En France au début des années quarante, le système de protection sociale en place n’est ni obligatoire, ni général. Il est assurantiel.
En Grande Bretagne, ou a été expérimenté le système Bismarck, le gouvernement britannique confie, en 1941, à William Beveridge, la mission de trouver un nouveau modèle social. Dans son rapport sur la « reconstruction », celui-ci propose un système universel et unifié de « sécurité sociale » couvrant l’ensemble de la population, active ou non, pour l’ensemble des risques, y compris le chômage. Les prestations et les cotisations devant être uniformes et la gestion unique.
En avril 1944, le Bureau international du travail organise la Conférence internationale de Philadelphie, dont la déclaration finale débute par la formule : « le travail n’est pas une marchandise».
Dans son texte conclusif, « La Conférence reconnaît l’obligation solennelle pour l’Organisation internationale du Travail de seconder la mise en œuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser […..] l’extension des mesures de sécurité sociale en vue d’assurer un revenu de base à tous ceux qui ont besoin d’une telle protection, ainsi que des soins médicaux complets ».
Avouons que, 70 ans après, ce texte, qui demeure, de manière générale, sans réalisation concrète, conserve une surprenante actualité.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, se manifeste dans plusieurs pays, l’aspiration à de nouveaux droits collectifs et le besoin de démocratisation économique et surtout de protection sociale.
En France, dans les combats contre l’occupant nazi et les tenants de la collaboration, s’élabore l’idée d’un changement novateur des mécanismes de protection sociale. L’exigence de progrès sociaux et démocratiques allant de pair avec la volonté d’indépendance nationale, le programme du CNR reflète un consensus forgé dans la lutte, par la Résistance, autour de la Nation et de la République. Ainsi doit se mettre en place une organisation de la société transformée, au profit de plus de justice, de plus de solidarité et de libertés équivalentes pour tous les citoyens. Pas de liberté sans protection, pas d’égalité sans solidarité ! C’est dans ce cadre que le programme « Les jours heureux », adopté dans la clandestinité, le 15 mars 1944, propose : « un plan complet de Sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence dans tous les cas où ils seraient incapables de se les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État.
Nous sommes là bien au-delà d’un simple mécanisme d’assurance mutuelle contre les risques que comporte la vie dans une société capitaliste. C’est un véritable projet de solidarité nationale. Mais qui sera dès le départ amputé d’une partie de ses potentialités.
Pour Ambroise Croizat « Faire appel au budget de l’État, c’est inévitablement subordonner l’efficacité de la politique sociale à des considérations purement financières qui risqueraient de paralyser les efforts accomplis ». Président de la commission sociale de l’assemblée provisoire à Alger, il impulse, dès avril 1944, un groupe de travail sur le sujet.
Les débats sont vifs.
Les enjeux portent sur l’étendue, l’unité du système et sa gestion. Croizat est en butte aux manœuvres du MRP opposé au principe de la Caisse unique et aux modalités de la représentation des travailleurs dans les conseils d’administration des organismes.
Pour Marcel Paul les choses doivent être simples : « A renouveau économique à la hauteur des besoins d’une Nation, statut social à la mesure des besoins des hommes ».
Le 24 juillet 1945, Georges Buisson, de la CGT, présente à la commission, le rapport qui constitue un projet d’ordonnance organisant la sécurité sociale. Il est adopté par 190 voix. Seul Joseph Denais de droite vote contre. Mais 84 s’abstiennent, membres du MRP, de la CFTC et Radicaux. Nous sommes loin de l’unanimité du CNR.
Bien que majoritaire, la position de l’assemblée n’est qu’un avis soumis au gouvernement. La décision du pouvoir exécutif, formulée dans l’ordonnance du 4 octobre 1945 sera une traduction déformée du programme du CNR : les régimes spéciaux et les régimes complémentaires sont maintenus, l’autonomie des Caisses d’allocations familiales s’oppose au principe de la Caisse unique, une certaine « souplesse » dans l’application apparait. Ambroise Croizat qualifie la législation adoptée « de compromis, mais un compromis très positif, réalisé sous la pression populaire ».
On peut, on doit s’interroger, sur les choix du gouvernement et le soutien de la CGT à cette entorse au régime unique. Non pour juger, mais pour essayer de bien comprendre. Une expérience de ce type peut être utile aux syndicalistes que nous sommes.
Peut-on affirmer, comme certains, que s’il n’y avait pas eu de faille dans l’ordonnance de 1945, les patrons, les réactionnaires, « n’auraient pas pu démanteler le système » ? Voilà de quoi ouvrir le débat !
Il est vrai que la situation en 1945 ne permet pas d’envisager dans l’immédiat la réalisation d’un programme aussi vaste que celui voulu au départ. La priorité est d’organiser le cadre de sa mise en œuvre tout en assurant dans l’immédiat, ce qui est nécessaire et possible.
Néanmoins, avec ce plan, la France se dote d’un régime de protection sociale original, de haut niveau et qui sera l’objet d’un enjeu majeur de la lutte des classes.
Le jour de la signature De Gaulle est absent. Il semble se désintéresser ou éviter de s’impliquer dans ce qu’il appellera toujours les « assurances sociales ». Dont par ailleurs, il n’hésitera pas, en 1948, dans un discours à Compiègne, de réclamer la réduction drastique.
C’est Alexandre Parodi, ministre du travail, qui signe les ordonnances du 4 et 19 octobre 1945.
Mais la dynamique est ailleurs. De 1945 à 1947 la CGT passe de 4 à 6 millions d’adhérents, la fédération des métaux frôle le million et, dès les élections d’octobre, le PCF est le premier parti de France.
C’est dans ce contexte qu’Ambroise Croizat est nommé ministre du travail et de la sécurité sociale le 22 novembre. Poste qu’il occupera jusqu’à l’éviction des ministres communistes par le gouvernement Ramadier en mai 1947.
Il s’entoure de collaborateurs dont le Directeur général de la Sécurité sociale, Pierre Laroque. Ce haut fonctionnaire a toutes les compétences requises. Il a suivi le dossier des Assurances sociales jusqu’en 1939 et travaille déjà, depuis plusieurs mois, à la demande de Parodi, sur la mise en œuvre du projet du CNR. Un lourd et difficile combat s’engage, au quotidien, pour la mise en place, dans des délais très courts, des nouveaux organismes. Car la Sécurité sociale n’est pas encore sur pieds. Pour l’heure tout reste à mettre en place.
Pour autant les opposants prennent déjà l’offensive.
Le MRP présente, dès le 22 décembre, une proposition de loi qui s’attaque à l’ordonnance du 4 octobre.
De Gaulle, décidément hors jeux sur ce dossier, quitte le gouvernement le 20 janvier 1946.
La Confédération Générale du Patronat Français, qui s’est rebaptisée CNPF à la veille de Noël 1945, soutient que la Sécurité Sociale mets en danger l’économie du pays. Elle veut surtout en écarter les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Même combat pour les compagnies d’assurance qui réalisent des profits indécents depuis la loi d’avril 1898, en gérant, pour leur compte, les blessures, mutilations et décès des salariés frappés au travail.
On reproche à la sécurité sociale son coût exorbitant qui détériore la compétitivité de la France au plan international et freine l’embauche. On la considère comme une institution qui vit au dessus de ses moyens, à la gestion douteuse, qui dilapide les moyens mis à sa disposition, incapable d’éviter les gaspillages, les dépenses inutiles et la surconsommation médicale. C’est une charge pour le patronat, le gouvernement et les experts de tous poils. Quand à certains médias ils sauront en rajouter, dans les décennies à venir, sur le trou de la sécurité sociale. Sans oublier les attaques permanentes organisées par les assurances, toujours à l’affut.
10 novembre 1948, chambre de commerce de Paris : « la sécurité sociale est devenue pour l’économie, une charge considérable… Les salariés ont profité de traitements dont ils n’avaient peut-être pas un besoin certain, la moindre maladie a été le prétexte de repos. L’absentéisme s’est développé ».
1949, Paul Reynaud, président du Conseil dénonce « la charge excessive des cotisations sociales qui rend notre situation économique intenable ».
Autant d’arguments, de phrases toutes faites, qui sont encore ressassées, 70 ans après, et toujours dans le souci affiché de l’adaptation aux réalités du monde moderne.
Le chercheur américain, Henry Galant, dans une publication du comité d’histoire de la sécurité sociale, écrira en 2005 : « Les défenseurs les plus actifs du nouveau plan de sécurité sociale et de son application étaient les communistes et la CGT… Qui était, de loin, le syndicat le plus puissant ». Et il rajoute : « pour la mise en place à partir du 1er juillet 1946, le gouvernement a reçu l’appui efficace des dirigeants communistes comme d’ailleurs des éléments non-communistes de la CGT… La centrale qui était, à cette époque, sans nul doute, l’organisation professionnelle la plus représentative… C’est grâce aux efforts de la CGT que les caisses furent prêtes à fonctionner à la date prévue ».
Pierre Laroque, dans un entretien en octobre 1995 à la revue Le droit ouvrier, rendra un hommage mitigé, à l’organisation syndicale : « Nous avons eu la chance, si c’est une chance, que la CGT ait été pratiquement seule en 1945 à représenter le monde du travail ».
Mais celui que l’on voudrait aujourd’hui considérer comme le père de la sécurité sociale a précisé sa position dans un avant-propos paru dans la revue française des affaires sociales de juillet 1985 : « le risque existait qu’une sécurité généralisée conduisit à développer chez les travailleurs un optimisme égoïste, à courte vue, une tendance à se laisser vivre, à s’endormir dans la satisfaction d’une médiocrité permanente… Il serait raisonnable, comme on l’a d’ailleurs commencé à le faire, d’augmenter la cotisation des bénéficiaires, et peut-être aussi celle de la collectivité, tout en réduisant celle des entreprises ». Il ajoutera en 1993 que la retraite à 60 ans était une erreur.
Et la CGT, elle en dit quoi ?
Le premier Congrès Confédéral convoqué après la Libération, se réunit du 8 au 12 avril 1946. Une résolution traite de la Sécurité sociale. Elle commence par émettre des réserves et au final donne une appréciation positive : « Bien que les textes actuels concernant la Sécurité sociale ne soient pas parfaits, le Congrès Confédéral renouvelle l’adhésion totale de notre grande centrale syndicale au plan ainsi établi. »
Et la résolution garantit : « Que tout sera mis en œuvre pour assurer la défense et la réussite d’une réforme qui constitue une amélioration considérable de la législation sociale française ».
La Confédération se montre lucide et ne lâche pas prise. En effet, après le jugement positif, le texte poursuit : « Néanmoins, le Congrès Confédéral tient à affirmer que des aménagements sont indispensables. La loi doit notamment être appliquée aux colonies et dans les protectorats français et en général, en faveur de toute la population active du pays ; ce qui implique également l’assimilation, le plus rapidement possible, du régime agricole au régime général. […]. »
Puis, la résolution égrène les points pour lesquels la CGT souhaite des améliorations : intégration des caisses de congés payés ; couverture du risque chômage, montant et attributions des pensions vieillesse, gestion de la Caisse nationale et aménagement des régimes spéciaux.
Ces régimes constituent alors une entorse aux principes, même si leur origine est parfois très ancienne, à l’image du système de retraite des marins créé par Colbert, mais aussi de celui de la Banque de France datant de 1806, des Chemins de Fer créé en 1855 et des Mines en 1894 pour ne citer qu’eux.
Ambroise Croizat déclarera lors de l’inauguration du nouveau système de sécurité sociale en juin 1946 : « Outre le fait qu’elle ouvre le droit à la santé pour tous, met fin à l’inégalité devant la souffrance et la maladie et aux angoisses du lendemain, le nouveau système de sécurité sociale basé sur la solidarité, a pour ambition de relever la France de ses ruines. Elle donne au salarié une tranquillité sociale qui lui permettra de reconstruire la France à l’ambition de ses rêves et de ses besoins
Et il poursuit le combat, mobilisant tous ceux qui veulent apporter « une solution durable pour éradiquer l’insécurité, l’incertitude du lendemain pour tous ceux qui vivent de leur travail, pour garantir à tous qu’en toutes circonstances, ils jouiront de revenus suffisants pour assurer leur subsistance familiale ».
Croizat est lucide et en appelle à tous les militants : « Rien ne pourra se faire sans vous. La Sécurité Sociale n’est pas qu’une affaire de lois et de décrets. Elle implique une action concrète sur le terrain dans la cité, dans l’entreprise. Elle a besoin de vos mains ».
Les premières élections pour la gestion, suite à la loi du 30 octobre 1946, se dérouleront le 27 avril 1947.
La CGT obtient 59, 27 % des voix dans le collège salariés pour les administrateurs des caisses de Sécurité sociale et 62% dans le collège caisses d’allocations familiales.
La CFTC (10 % des suffrages), refuse de siéger dans les premiers Conseils d’administration.
Durant les 15 premières années, les travailleurs qui disposaient des ¾ des sièges, ont géré complétement les caisses. Montrant ainsi la capacité de la classe ouvrière à gérer un budget supérieur à celui de l’état. Ce qui est insupportable au patronat. Par le décret du 12 mai 1960, les pouvoirs du directeur sont renforcés, au détriment du conseil d’administration. En 1967 la réforme De Gaulle/Jeanneney mets un terme aux élections du conseil et instaure le paritarisme. Son rétablissement en 1983 par François Mitterrand sera de courte durée. Les élections de 1989, repoussées par le gouvernement socialiste, seront définitivement supprimées par les ordonnances Juppé en 1995.
En 2004, la loi Douste-Blazy supprime carrément les conseils d’administration pour y substituer des conseils d’orientation. Cette loi qui donne quasiment les pleins pouvoirs au directeur de la CNAMTS, fait entrer les complémentaires (assurances privées et mutuelles) dans une union nationale des caisses complémentaires d’assurance maladie (UNOCAM), ou elles disposent du pouvoir de peser sur les remboursements. La privatisation est en marche.
La sécurité sociale française est un organisme de droit privé exerçant une mission de service public. Elle n’a ni actionnaire, ni PDG. Elle est une propriété sociale. Les gouvernements qui exercent une garantie et un contrôle, a posteriori, n’ont pas de légitimité pour la détruire.
L’élaboration du nouveau plan de sécurité sociale de 1945 allait bien au delà de la seule conception de la protection sociale car ses options engageaient l’ensemble de la politique économique et sociale. C’est en cela qu’elle sera immédiatement l’objet de l’opposition de certaines forces politiques et syndicales.
Aujourd’hui, face aux attaques et aux reculs successifs, la résistance ne peut suffire. Il faut redynamiser le système, pour le développer et le porter au niveau des exigences et des besoins actuels.
Pour la CGT, la sécurité sociale doit être professionnelle, c’est à dire protectrice de tous les moments de la vie. Et bien sur en lien avec l’exigence d’un réel plein-emploi et de meilleures conditions de vie et de travail.
Doit-on définitivement renoncer à la gratuité des soins et de l’accès au système de santé ?
Un contrôle public et social de l’industrie pharmaceutique n’est-il pas nécessaire face aux dérives tarifaires, à la politique de recherche axée sur les seules molécules rentables et à des formes de pénurie issues de l’alimentation des seuls territoires prêts à payer au meilleur prix ?
Tout cela avec la complicité de l’État.
Quelle ambition cultive t-on en renonçant à l’universalité dans le cadre de la politique familiale, alors que demeurent des questions cruciales comme le travail des femmes la garde des enfants, la scolarisation, la situation des familles les plus démunies ?
Et l’allongement de l’espérance de vie, incontestable progrès de civilisation, mais dont les diverses classes et couches sociales ont très inégalement bénéficié. Faut-il qu’il se traduise par un inévitable allongement de l’exploitation ?
Le caractère démocratique de la gestion des institutions de sécurité sociale doit être rétabli et développé pour les dégager de l’emprise étatique, pour permettre une gestion créative.
Une des questions cruciale et des plus urgentes est le financement. La mise en place d’une cotisation sur les revenus financiers des entreprises mais aussi et surtout les banques et les institutions financières est la seule réponse.
Les ressources de la sécurité sociale ne sont pas indépendantes de l’évolution économique. Ce qui implique des changements structurels dans le sens de l’émancipation sociale et dans la perspective de dépassement du système capitaliste.
Ces ambitions, reconsidérées à l’aune des réalités de 2016, sont fidèles aux principes et aux aspirations de transformation sociale que portait Croizat et ces camarades de lutte de 1936 à 1946.
Aujourd’hui, dans un monde plus que jamais instable, injuste et cruel, ou le repli communautaire et religieux s’amplifie à la mesure du renoncement et de l’abandon des dirigeants politiques, ou règne une seule et unique loi, celle du profit, ou la quasi totalité des médias participe activement au dogme libéral, ou la pensée unique condamne toute alternative hors de l’économie capitaliste, un tel chantier peut paraitre insurmontable et un tel combat perdu d’avance.
Mais n’avons nous pas connu et affronté dans notre histoire des périodes plus noires et des avenirs plus sombres ?
La première bataille est de ne pas céder, de rappeler ce que fut et ce que devrait être un véritable régime de protection sociale à la hauteur de la dignité humaine.
Notre première responsabilité est de persévérer à en parler, en débattre, quelques soient les réactions.
Denis Diderot, ce grand esprit des lumières, qui ne s’arrêtait pas aux critiques et aux réactions violentes face à la vérité, écrivait il y a 250 ans : « si vous introduisez un rayon de lumière dans un nid de hiboux, vous ne ferez que blesser leurs yeux et exciter leurs cris ».
Et s’il le faut, rappelons-nous les propos d’Ambroise Croizat quelques semaines avant de disparaitre : « Jamais nous ne tolérerons qu’un seul des avantages de la Sécurité Sociale soit mis en péril. Nous défendrons à en perdre la vie et avec la dernière énergie cette loi humaine et de progrès… »