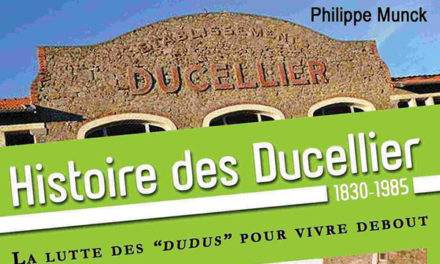Gravé dans l’imaginaire populaire, le 10 mai 1981 symbolise encore aujourd’hui la victoire du peuple de gauche. L’émotion est réelle le soir même, place de la Bastille. Pour beaucoup, après 23 ans de règne sans partage de la droite, c’est le bulletin de l’espérance qu’ils ont mis dans l’urne. Mais l’accession au pouvoir de François Mitterrand ne sera pas une révolution sociale.
Le besoin de rassemblement
Les grandes conquêtes sociales, en 1936 ou 1945, ont été le fruit de l’unité. La victoire électorale de 1981 n’échappe pas à cette règle. Les grandes luttes revendicatives des années soixante ont placé les organisations syndicales devant leurs responsabilités : un accord d’unité d’action est signé en 1966 entre la CGT et la CFDT. Suite aux mouvements revendicatifs de 1968, des accords sont signés au niveau national et dans les branches. Mais la crise économique éclate avec le premier choc pétrolier (1973) et accélère les désindustrialisations : charbonnages, textile, sidérurgie, construction navale ou encore machine-outil sont lourdement frappés. La France découvre le chômage de masse, avec 1,7 million de demandeurs d’emploi au début des années 80.
La rupture
Mitterrand, candidat unique de la gauche aux présidentielles de 1965 et 1974, rassemble les socialistes face au parti communiste au congrès d’Épinay (1971) qui acte la rupture avec le capitalisme. C’est sur cette base que naît le programme commun de la gauche en 1972 qui engage socialistes, communistes et radicaux. La CGT et la CFDT participent activement à sa diffusion. Mais gagner le rassemblement ne suffit pas. Les élections municipales (1977), puis législatives (1978) n’ébranlent pas la majorité de droite.
La méfiance, l’exigence des uns et la frilosité des autres, font exploser le programme commun. Les communistes formuleront 131 propositions face aux 110 des socialistes. La véritable rupture est peut-être là. Mais l’aspiration à l’unité reste forte chez les salariés.
Le coût du changement
Aux élections présidentielles chacun fait le choix d’un homme pour construire l’avenir. Dans un contexte de guerre froide, de vague conservatrice et néo-libérale, on ne dénombre pas moins de dix candidats. Au second tour, les appels au report des voix sont frileux et contraints. Mais la volonté de changement, le rejet de Valéry Giscard-d’Estaing, hautain et distant, triomphe. Son désormais fameux « au revoir » sera définitif.
Les avancées sociales sont réelles : retraite à 60 ans, semaine de 39 heures, 5e semaine de congés payés, nationalisations, impôt sur la fortune, abolition de la peine de mort. Mais dès 1983, le tournant de la rigueur impose le blocage et la désindexation des salaires, les coupes budgétaires et le départ des ministres communistes en juin 1984. Les avancées sociales auraient ruiné la France. Mais on parle peu de la fuite des capitaux et des attaques permanentes contre le franc.
La CGT, comme la CFDT, sont sanctionnées dans les élections professionnelles comme dans la syndicalisation. De nombreux salariés les associent à la politique de rigueur du gouvernement et désapprouvent leur proximité avec le pouvoir. Associée à la poursuite de la désindustrialisation, le résultat est dévastateur : entre 1978 à 1992, la CGT perd 70 % de ses adhérents.
Avec le recul, on peine à mesurer l’émotion populaire qu’a suscité cette victoire électorale. Les avancées obtenues ne masquent toutefois pas la désillusion de ceux pour qui tout devenait possible.